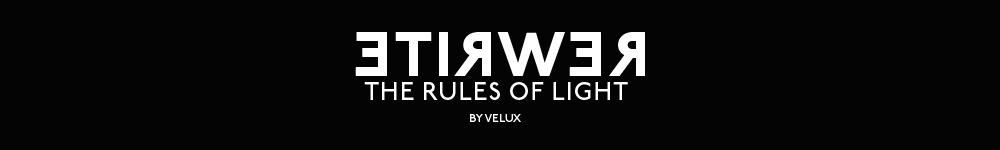On croit, en architecture, que la lumière se contente de révéler l’espace. Pour Vincent Callebaut, elle devient force vitale, adoucit les climats hostiles, redonne souffle aux murs et ranime la cité. Architecte belge installé à Paris, il conçoit des bâtiments vivants, où la lumière devient force vitale, énergie maîtrisée, dialogue permanent avec la nature. Et parfois… remède.
Rewrite the Rules of Light est une série réalisée en collaboration avec VELUX. Rendez-vous les mois prochains pour de nouveaux invités. Tous les articles de ce dossier sont disponibles via ce lien.
Il est né à Soignies, dans le Hainaut, dans un décor de briques rouges et de toits d’ardoise. Vincent Callebaut a emporté avec lui cette lumière du Nord jusque dans ses projets parisiens et internationaux. Diplômé de l’institut Victor Horta à Bruxelles en 2000, il rejoint Paris sur l’invitation d’Odile Decq, puis parcourt le monde aux côtés de grands noms de l’architecture.

Dix années d’apprentissage, avant de fonder sa propre agence et de déployer sa vision : celle d’une architecture dans laquelle l’esthétique rencontre la rigueur technique. C’est là toute sa « Belgitude », comme il aime l’appeler : un équilibre entre la créativité latine et la précision anglo-saxonne. La Belgique, à ses yeux, tient ce rôle d’entre-deux, voisin des pays scandinaves, dans cette capacité à allier poésie et pragmatisme.
Faire de la lumière une alliée contre le dérèglement climatique
« La lumière est le premier matériau des architectes », rappelle Vincent Callebaut. Une évidence, mais qui prend aujourd’hui un sens nouveau face à un climat déréglé où cette matière première devient, année après année, une source de danger en milieu urbain.
Le constat est sans appel, mais pas réellement neuf pour l’architecte, qui l’a compris dès le début de sa pratique. « La ville suffoque sous les dômes de chaleur, les façades captent davantage qu’elles ne réfléchissent. » Face à cette urgence, Vincent Callebaut propose une réponse bioclimatique : faire entrer la lumière quand elle est vecteur de chaleur en hiver, l’apprivoiser ou l’atténuer quand elle brûle, l’été.

Pour lui, la lumière n’est ni bonne ni mauvaise. Elle est une matière en mouvement, à sculpter selon les saisons. Son architecture n’est pas un refuge contre la lumière, mais une passerelle entre elle et nous. Le Belge conçoit ainsi des bâtiments vivants, où la lumière n’est plus seulement un spectacle visuel, mais une force vitale, une énergie maîtrisée, un dialogue permanent avec la nature.
Sculpter les ombres, faire danser la lumière
À Montpellier, son projet « Jardins secrets » est un manifeste de cette approche sensible. Ici, les façades ne sont pas lisses, mais sculptées. Un moucharabieh géant filtre la lumière, joue avec les ombres et laisse l’air circuler. Le slogan du lieu résume tout : « sculpter les ombres et faire danser la lumière ». Résultat : même sous 42 °C, les habitants vivent dans des espaces où la température intérieure reste stable, sans climatisation mécanique.

Ailleurs, dans ses forêts verticales, à Taïwan ou en Chine, les arbres eux-mêmes deviennent des filtres vivants. Plantés sur des balcons doubles hauteurs, ils laissent la lumière basse pénétrer en hiver et créent une ombre bienveillante en été. Là encore, l’équilibre est recherché, jamais imposé.
Une alliance avec la nature et la technologie
L’arbre, climatiseur naturel, n’est pas seul dans cette quête. La lumière est aussi guidée par des technologies discrètes. Brise-soleil orientables, capteurs de chaleur, systèmes connectés : autant d’outils pour adapter les façades aux saisons et aux usages. L’important, pour Vincent Callebaut, est d’orchestrer cette lumière naturelle : « capter sa douceur quand elle réchauffe les cœurs, en modérer l’intensité quand elle devient brûlante ». Sans jamais couper le lien avec l’extérieur, sans jamais enfermer.
Cette architecture climatique est une architecture joyeuse. Elle n’oppose pas nature et technologie : elle les réconcilie.

Une architecture et une écologie pour tous
On lui a parfois reproché de construire des bâtiments réservés à une élite, trop ambitieux , trop sophistiqués. Vincent Callebaut rétorque par l’exemple. À Montpellier, comme à Aix-les-Bains, des projets bioclimatiques et végétalisés se vendent aux prix du marché local, accessibles au plus grand nombre. Chacun intègre d’ailleurs 30 % de logements sociaux et abordables pour assurer la mixité sociale. Mieux encore, « dans ces immeubles écoresponsables, ces logements sociaux bénéficient des mêmes innovations que les logements privés en accession : façades végétalisées, gestion durable de l’eau, réduction des besoins en énergie ».
Son ambition est claire : prouver que l’écologie et la haute technologie ne sont pas réservées à quelques-uns, mais peuvent améliorer la qualité de vie de tous. Habiter un bâtiment qui produit sa propre énergie et recycle ses ressources, c’est, à son échelle, participer à réparer le monde.

Rien d’étonnant à ces affirmations : Vincent Callebaut aime à penser que l’architecte est, par la force des choses, devenu « le médecin de la ville ». Un bâtisseur qui ne part pas d’une page blanche, mais qui soigne l’existant, adapte le bâti existant aux nouvelles réalités climatiques. Dans les villes historiques, l’urgence consiste à repenser les orientations, corriger les erreurs du passé, et inventer des façades qui dialoguent (enfin) avec le soleil et les vents.
Enseigner la lumière
S’il devait transmettre sa vision à de jeunes architectes, Vincent Callebaut leur parlerait de la lumière sous toutes ses formes : lumière visible, chaleur invisible, énergie pour les plantes, ombre nécessaire. Il leur apprendrait à ne pas opposer confort d’été et d’hiver, à penser la lumière comme un équilibre fragile, à conjuguer l’intuition artistique et la rigueur technique.
Pour le Belge, la lumière est une matière vivante : « Elle n’est pas figée dans un cadre. Elle traverse, filtre, danse, sculpte, apaise. »
Son dernier livre, Villes 2050 (Éditions Eyrolles), trace les contours d’un avenir possible : des bâtiments vivants et sobres, qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Des lieux où la lumière n’est pas un décor, mais un souffle vital, au service d’une architecture durable. Et sensible.