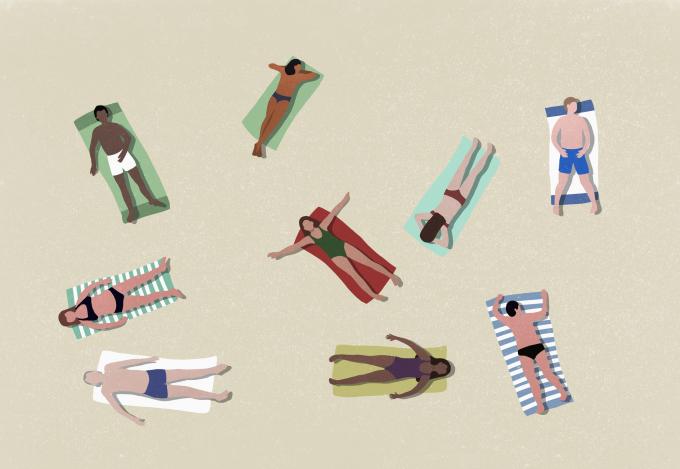Dans un monde où la valeur-travail est érigée en valeur absolue, l’autrice Lydie Salvayre signe un essai salvateur. Elle nous enjoint de ne jamais renoncer à notre droit à la flânerie, à l’insouciance et à la paresse. Le mantra parfait pour profiter de l’été.
Attitude maudite, assimilée tour à tour à la mollesse, à la torpeur, à la passivité, ou encore à l’inertie, la paresse a mauvaise presse de nos jours. «Une anomalie», fustigent les zélateurs de la valeur-travail; «un péché», surenchérissent les croyants de tous bords. A rebours de cette conception dominante, Lydie Salvayre, lauréate du prestigieux prix Goncourt en 2014, se livre dans son dernier ouvrage Depuis toujours nous aimons les dimanches (Seuil) à un puissant éloge de l’«art de paresser».
Attention: on aurait cependant tort de croire que cette autrice, subtile et érudite, verse dans la provocation. La paresse, telle qu’elle la conçoit, est, au contraire, une attitude puissamment active. «Paresser n’est pas ne rien faire. Paresser, c’est faire mille choses, mais qui n’obéissent pas aux lois qui régissent la société marchande, à savoir le rendement, le chiffre, le profit, la performance, l’utilité, l’abondance, etc.», nous confie-t-elle.
Dans cette ode malicieuse, espiègle et vive, où la beauté du style le dispute sans cesse à la force des convictions, elle se propose de dire la sagesse des paresseux, injustement dénigrés. Un ardent plaidoyer pour la flânerie, la création libre, l’insouciance libératrice. Puisant au meilleur de la littérature et des sciences sociales, de Guy Debord à Henri Michaux, c’est à un remarquable effet d’éclairage et de démonstration que parvient Lydie Salvayre dans cet audacieux petit essai, grandement bienvenu en cette saison estivale.
L’été vous semble-t-il la saison la plus propice à la paresse que vous appelez de vos vœux? Peut-on parler de «paresse estivale»?
Il est vrai que l’été semble être la saison idéale pour se soustraire aux affaires sérieuses, aux raisons efficaces, à l’enchaînement morne du quotidien, à l’injonction incessante de faire, de faire, de faire et de remplir nos vies d’affairements qui nous donnent le sentiment d’exister. C’est la saison idéale donc pour suspendre le travail qui nous absorbe d’ordinaire, qui souvent nous épuise et nous rend aveugle, sourd, ou étranger à tout le reste.
Cette saison est aussi celle des voyages, de la lecture, du bricolage, etc. Ces activités correspondent-elles à l’art de la paresse?
L’été est également la saison idéale pour résister aux gestes machinaux qui semblent aller de soi et nous gouvernent sans qu’on en ait conscience. Saison idéale aussi pour faire halte enfin, non pas pour s’abstraire du monde et s’en dessaisir, mais pour le saisir autrement et en user autrement. Saisir la douceur de l’air, la beauté d’un paysage, le souffle d’un vent marin, la clarté d’un ciel. Consacrer du temps à ceux-là qu’on aime. Jouer comme un enfant à des jeux inutiles, nager, buller, danser, musiquer, rêver, admirer la beauté, parler aux oiseaux, consacrer du temps à l’amitié, lire les livres qui ont moisi durant des mois, abandonnés sur la table de nuit… Mais la paresse n’est pas seulement estivale. Elle peut s’éprouver en toute saison. Lire un roman de Balzac, l’hiver, au coin d’un feu, se promener dans les bois à l’automne, semer des coquelicots au printemps… autant d’activités délicieuses qui relèvent de la paresse telle que je l’entends, telle que nous sommes un certain nombre à la concevoir.
Vous insistez sur le fait que la paresse n’équivaut pas à l’«inertie de l’esprit»…
Les apologistes du travail ont tendance à considérer la paresse comme un déficit qu’il faut corriger, un vice à extirper, un péché, une faiblesse morale, une apathie, une torpeur, un engourdissement, une léthargie, une inertie du corps et de l’esprit… qu’ils dénomment flemme, glande, feignardise et autres termes peu flatteurs. Or paresser n’est pas ne rien faire. C’est, pour simplifier, faire tout ce qui échappe au dogme de la productivité à tout prix. C’est par exemple lire, méditer, contempler, prendre soin de soi et des autres, converser, se parcourir disait le poète Henri Michaux, laisser son âme nager ajoute-t-il, jardiner, bricoler, faire la fête, faire l’amour…. Réaliser toutes ces choses qui n’ont pas de prix et rendent notre vie vivante et désirable.
‘La pensée est flâneuse. La pensée aime à prendre des chemins buissonniers, musarder, vagabonder, errer; et la paresse lui permet d’avancer.’
Or, il semble que nous ayons perdu le sens du désœuvrement en même temps que celui de la fête. Les deux sont indissolublement liés. Et nombreux sont ceux parmi les intellectuels, comme Guy Debord, auteur du célèbre essai La société du spectacle, qui ont annoncé que la fête était finie, que sa puissance de rupture, son exubérance, sa force contestatrice, les excès à quoi elle appelait, ont disparu, qu’elle n’était plus qu’une vulgaire opération marchande.
Ne partagez-vous pas leur constat?
Nous désirons tous, j’en suis persuadée, retrouver ce goût de la fête qu’on dit perdu. Nous le désirons tous parce que nous sommes des enfants interminables. Nous aimons tous réaliser des choses qui ne servent à rien parce qu’il y a en nous cet increvable et rapace «besoin d’envol» dont parlait le poète Antonin Artaud.
Plus globalement, quelles sont selon vous les autres vertus (insoupçonnables) de la paresse?
L’une des grandes vertus de la paresse est qu’elle constitue, me semble-t-il, l’une des conditions de la pensée. On connaît la célèbre histoire d’Archimède, se prélassant dans son bain, ses jambes doucement soulevées par la pression de l’eau, qui conçut en un instant l’un des grands principes de la physique. Et la légende de Newton, qui paressait délicieusement sous un pommier lorsque la chute d’une pomme lui révéla l’idée de la gravitation universelle.
Tout le monde, je crois, a fait un jour cette expérience: on se prélasse sur un divan l’âme indolente, on musarde la tête ailleurs, on déambule sans but précis, quand l’idée, le mot, la chose que l’on cherchait depuis des jours, surgit soudain. C’est que la pensée n’a pas un trajet rectiligne. La pensée est flâneuse. La pensée aime à prendre des chemins buissonniers, musarder, vagabonder, errer; et la paresse lui permet d’avancer ainsi «à sauts et gambades», pour reprendre la belle expression de Montaigne.
A part stimuler la pensée, la paresse a-t-elle d’autres vertus?
En effet. Et c’est La Rochefoucauld, un moraliste du XVIIe siècle, qui, sans aucun doute, les décrit le mieux. La paresse de mentir, dit-il, nous fait sincère, la paresse d’intriguer nous fait honnête, la paresse de se battre nous fait pacifique, la paresse d’entreprendre nous fait voluptueux, la paresse de riposter à la bêtise nous évite les aigreurs d’estomac, la paresse d’envisager le malheur, d’une certaine façon, nous en préserve. Et il en conclut, non sans ironie, qu’il faut très peu d’efforts au paresseux pour être bon. La paresse possède aussi cette vertu d’augmenter notre charme. Qui pourrait considérer comme charmant un individu qui s’agite, trépigne, transpire, et parle haut et fort?
Dans un monde ultraconnecté, où l’on est en permanence (virtuellement) sollicité, dans quelle mesure la paresse vertueuse que vous décrivez est-elle encore possible?
Il faut aujourd’hui avoir l’air affairé, ou mieux encore débordé, pour en imposer. Il faut que notre attention soit sans cesse sollicitée. Il faut passer sa vie à compter ses amis sur Facebook, lire des inepties sur X, comptabiliser ses «likes», s’abreuver d’infos qu’on aura oubliées dès le lendemain. L’une des raisons de mon livre est de réinterroger cette obsession fanatique d’avoir à s’occuper, à se remplir sans cesse, et de se demander par la même occasion ce que signifie vraiment réussir sa vie.
Comment éviter que le temps de paresse ne se transforme en temps de loisirs et de divertissement?
C’est l’une des questions qu’aborde le livre. Nous sommes si peu éduqués, si peu préparés à la paresse, que, lorsque cesse le travail, la peur du vide et de l’ennui nous assaille, et nous nous jetons à corps perdu dans ces occupations proposées par ce que quelques essayistes ont appelé le grand Marché de la Consolation. Ce marché est de plus en plus florissant et offre, en vrac, des ateliers d’aquarelle, de tango, d’écriture, de modelage, de macramé, de maquillage, de magie, de développement personnel… que sais-je; autant d’amusettes très prisées de nos populations vieillissantes qui n’ont aucunement conscience que ces occupations ne sont que la continuation impensée du travail, occupations grâce auxquelles on s’épuise à se désennuyer. C’est ce qu’en d’autres temps, mon cher Blaise Pascal nommait «le divertissement», c’est-à-dire toute activité nous permettant d’oublier la misère et la précarité de notre condition, de tromper notre propre néant et de nous détourner de l’idée de notre finitude.
Vous refusez que les dimanches, les moments de paresse, ne soient que de simples parenthèses éphémères. Comment faire durer ces moments face aux injonctions de notre réalité socio-économique?
Bertrand Russell, grand philosophe et mathématicien, avançait déjà en 1932, dans son Eloge de l’oisiveté, que ce culte du travail qui amenait les hommes à travailler toujours plus était déraisonnable et qu’il fallait absolument y mettre un terme. Il appuyait sa démonstration sur deux arguments. Le premier était que la fameuse valeur-travail n’était qu’un préjugé des classes dominantes, lesquelles estimaient que l’absence d’activité précipitait fatalement les classes pauvres dans l’ivrognerie et la dépravation. Le second, que la production industrielle pouvait assurer avec un minimum de travail les besoins de tous les êtres humains. Il estimait, en conséquence, que, grâce à la technologie moderne, la somme de travail requise pour procurer les choses indispensables à la vie pouvait se limiter à quatre heures de travail par jour.
Auriez-vous des pistes de solution?
Une solution de bon sens consisterait, disent ces chercheurs, à répartir de façon plus juste le temps de travail, de sorte qu’il n’y ait plus d’un côté des gens qui sur-travaillent, parmi lesquels des enfants (on estime qu’ils sont 160 millions à travailler dans le monde), et de l’autre des gens qui pâtissent d’être chômeurs et pauvres en conséquence. Mais mon livre n’a pas la prétention de présenter un programme voué à réformer le travail. Il cherche juste à requestionner, à reconsidérer la fameuse «valeur-travail» à laquelle certains adhèrent avec une impétueuse certitude et dans le déni monstrueux de ses failles, tandis que d’autres en souffrent dans leur âme et leur corps.
On pourrait vous objecter que vous êtes utopiste, voire que vos conceptions sont chimériques…
Les arguments d’experts démontrant la nocivité de la surproduction liée au sur-travail sont innombrables autant qu’incontestés: réchauffement climatique, pollution de l’air, de l’eau, des sols, extinction d’espèces, surabondance d’excitations lumineuses, sonores et émotionnelles qui émoussent nos sensibilités, lesquelles exigent désormais, pour ne pas s’étioler, toujours plus de stimulants: un meurtre bien sanglant, des viols à répétition, une guerre à venir… création de besoins totalement factices qui peu à peu nous deviennent aussi vitaux que l’oxygène, mort du silence, mort de la nuit, etc. Ne serait-il pas temps d’arrêter cette course au désastre ?
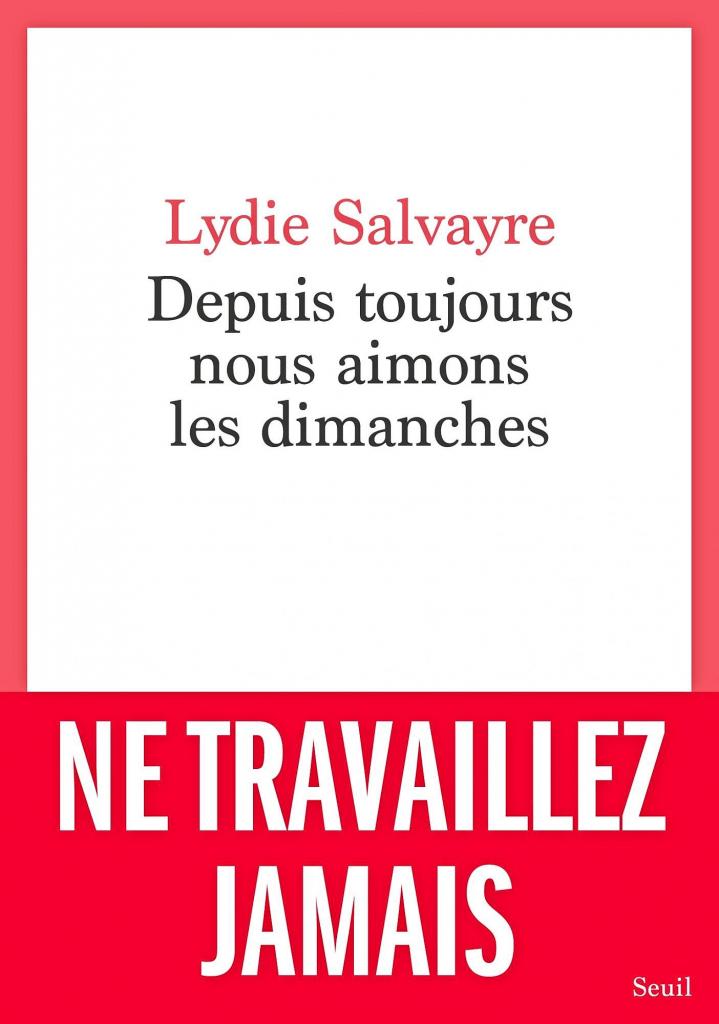
Depuis toujours nous aimons les dimanches, par Lydie Salvayre, Seuil, 144 pages.
EN BREF
Lydie Salvayre
– Lydie Salvayre est née de
parents espagnols réfugiés en France en 1939.
– Elle a fait des études de lettres, puis de médecine et de psychiatrie, et a longtemps exercé comme pédopsychiatre.
– Elle a écrit de nombreux romans traduits dans une trentaine de langues. Certains ont été adaptés au théâtre, notamment La Médaille, La Compagnie des Spectres, Pas Pleurer et Hymne.
– Elle a obtenu le Prix Hermès du Premier Roman pour La Déclaration, le Prix Novembre (aujourd’hui Prix Décembre) pour La Compagnie des Spectres, le Prix Goncourt pour Pas Pleurer et le prix Marguerite Yourcenar qu’elle recevra le 30 juin 2024.
– Elle a successivement collaboré avec les musiciens Serge Teyssot-Gay, Bruno Chevillon, Claude Bathélemy et Benoist Bouvot.