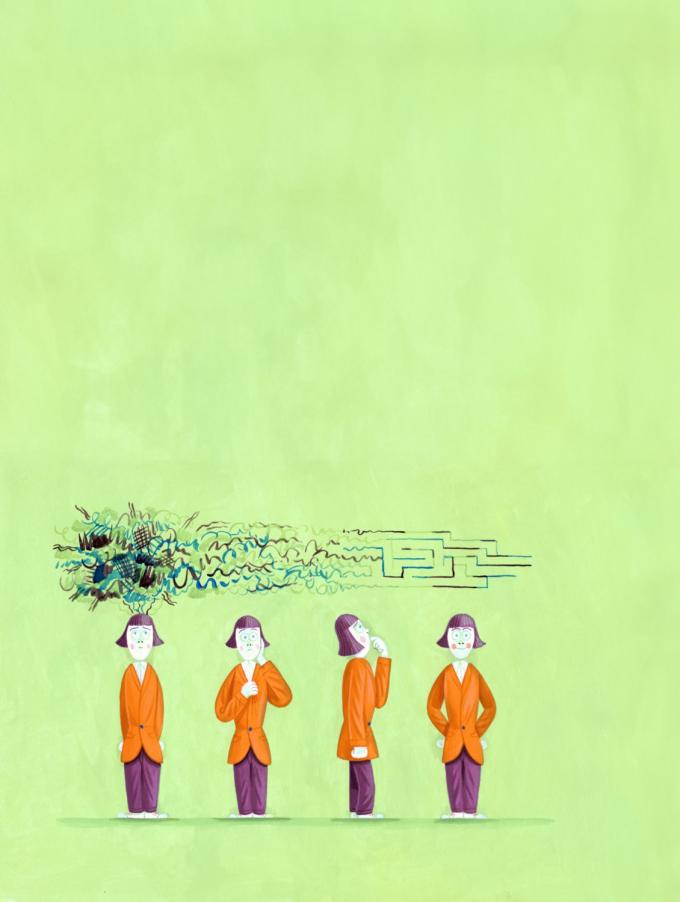Longtemps perçues comme un poison mental, les ruminations sont en phase de réhabilitation. Selon le psychologue Yves-Alexandre Thalmann, qui consacre un livre au sujet, elle peut même devenir un moteur d’adaptation, de créativité et de compréhension de soi.
«Parfois, j’aimerais pouvoir appuyer sur un bouton pour arrêter de penser, mais en vérité, je ne le souhaite pas vraiment.» Depuis l’adolescence, Fanny (38 ans), professeure de français, confie entretenir avec ses ruminations une relation ambivalente: «Il m’arrive de me repasser certains souvenirs en boucle, des phrases échangées il y a cinq ans, des actes manqués. C’est pénible, oui. Mais c’est aussi en ruminant que j’ai trouvé l’inspiration pour écrire mes cours ou préparer mes séquences. C’est comme s’il me fallait mâcher longuement une idée avant de pouvoir l’avaler.» Si elle avoue avoir un temps cru que ce fonctionnement était un frein, elle l’assume désormais comme un trait constitutif de sa manière d’être au monde.
Son témoignage fait écho au propos d’Yves-Alexandre Thalmann, professeur de psychologie et auteur du livre Éloge des ruminations mentales qui renverse la perspective dominante. Contrairement à l’image négative qui leur est accolée, les pensées qui tournent en boucle pourraient bien remplir une fonction insoupçonnée. «Les ruminations mentales sont des pensées à répétition, des «repensées», au sens littéral du terme, alimentées par des émotions pénibles comme l’anxiété, les regrets, la culpabilité… Ces repensées occupent une part non négligeable de notre vie psychique et personne ne semble épargné», explique-t-il. Selon lui, leur omniprésence dans notre vie intérieure invite à les considérer autrement.
Poser ses pensées
«Comment dès lors imaginer qu’un phénomène aussi commun et courant soit une erreur de l’évolution, un poison nocif?», s’interroge-t-il. Comme les émotions dites «négatives», souvent injustement diabolisées, la rumination aurait elle aussi une utilité: «Nous permettre de nous adapter au mieux et de trouver des solutions à des problèmes en y revenant plusieurs fois.»
Il n’y a pas d’émotions inutiles, ni de pensées spontanées à éliminer.
Cette approche trouve un certain écho dans les milieux scientifiques. Plusieurs recherches récentes ont ainsi souligné que notre flux de pensées spontanées, souvent qualifié de «vagabondage mental», occupe une place immense dans notre vie psychique, jusqu’à 50% du temps de veille, selon certaines estimations. Et que ces ruminations, loin d’être toujours parasites, sont parfois le lieu d’associations nouvelles, de prises de conscience, voire de gestes créatifs.
Un usage conscient
C’est en tout cas ce que confirme la trajectoire de Léo, 41 ans, ingénieur reconverti dans l’illustration. Pendant ses années de carrière dans le secteur énergétique, il confie avoir été «rongé» par ses ruminations. «Je me repassais les moindres échanges avec mes supérieurs, mes hésitations en réunion, mes retards, mes erreurs de jugement, raconte-t-il. J’en devenais insomniaque. Mais ce que je croyais être un problème s’est révélé être une matière à exploiter.»
En quittant son poste pour se lancer dans une activité plus artistique, il s’est mis à mettre en images ses pensées en boucle. «Je me suis rendu compte que mes cogitations racontaient quelque chose, que je pouvais les traduire, les canaliser. Elles m’aidaient à comprendre mes peurs, mes désirs, mes contradictions.» Selon Thalmann, la clé réside précisément là: ne pas chercher à «faire taire» ces ruminations, mais à en faire un usage plus conscient. Il n’y a pas d’émotions inutiles, pas plus qu’il n’y a de pensées spontanées à éliminer. Il y a simplement des formes d’attention plus ou moins bénéfiques que nous leur portons. En ce sens, les ruminations seraient moins un poison qu’une ressource inexploitée, un mouvement intérieur dont les effets dépendent de notre manière d’y répondre.
Apprivoiser et s’adapter
Ce n’est qu’à 39 ans qu’Alice, enseignante dans le secondaire, a découvert qu’elle ruminait depuis toujours. «Je pensais juste que j’étais anxieuse, perfectionniste, du genre à refaire mentalement toutes mes journées, mes cours, mes discussions avec les élèves ou mes collègues», raconte-t-elle. La nuit venue, impossible de mettre son cerveau en pause. «Je pensais à ce que j’aurais dû dire, à ce que je devrais mieux faire… Mais sans jamais vraiment avancer. Ça tournait en rond.»
Lorsqu’un médecin lui parle pour la première fois de «rumination mentale», elle tique. Le mot lui évoque l’inertie, voire la névrose. Et pourtant. «C’était exactement ça. Mais bizarrement, ça m’a aussi déculpabilisée. J’ai compris que ce n’était pas une tare, mais un mode de fonctionnement. Qu’il suffisait peut-être d’en faire quelque chose.» Comme l’explique Yves-Alexandre Thalmann, cette mécanique intérieure n’a rien d’un bug mental.
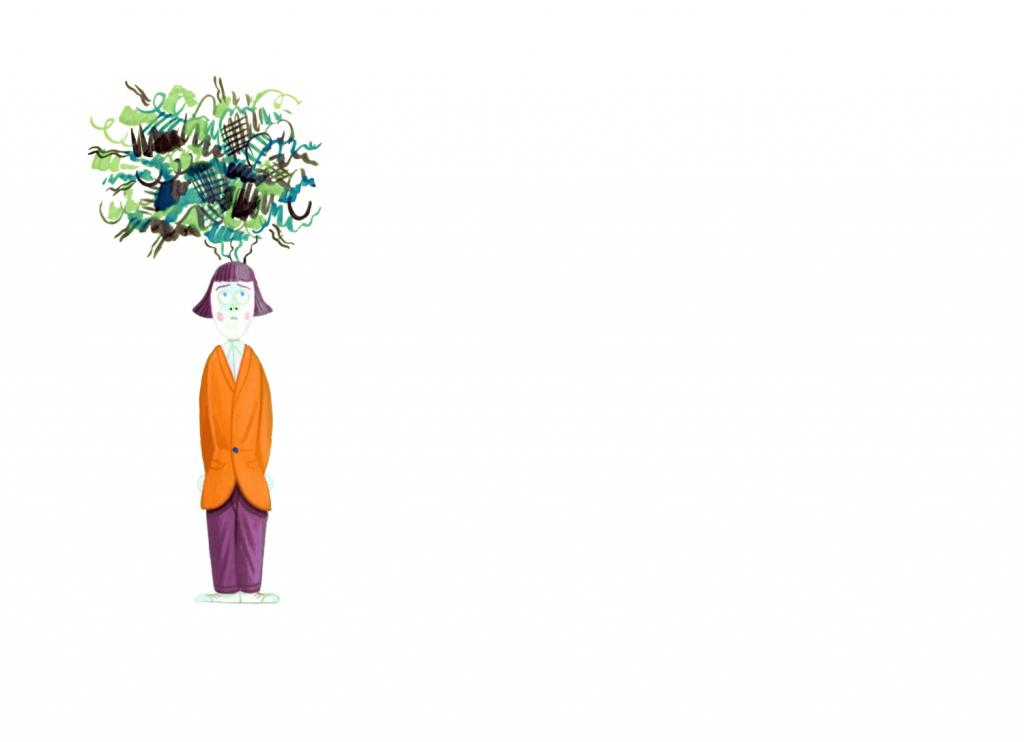
«De même qu’il n’y a pas d’émotions négatives, car toutes présentent une utilité, comme nous protéger d’un danger pour la peur ou nous dynamiser pour vaincre un obstacle pour la colère, la repensée est également utile: ruminer est avant tout une fonction adaptative, une manière pour l’esprit de revenir sur une situation problématique, de l’intégrer et d’esquisser des solutions. Ce n’est donc pas le fait de ruminer qui pose problème, mais la façon de le faire.
Eviter le jugement
Les études le confirment: il existe plusieurs types de ruminations. Les ruminations dites réflexives, tournées vers la compréhension ou la résolution d’un problème, sont plutôt bénéfiques. En revanche, les ruminations soucieuses (anxiété projetée) ou dépressives (jugements négatifs sur soi) peuvent vite devenir toxiques. Dès lors, il s’agit d’apprendre à distinguer les pensées spontanées, qui sont en réalité l’activité par défaut du cerveau, des ruminations choisies ou subies. Le professeur Thalmann conseille de différer intentionnellement les cogitations: «Dire à son cerveau, pas maintenant, mais dans 5 minutes, ou à la pause, ou ce soir.»
Le fameux «Eurêka» serait souvent le fruit d’un long brassage intérieur.
En d’autres termes, on peut laisser passer les pensées spontanées sans décider d’y consacrer de l’énergie. Et pour éviter que celles qui sont vraiment obsédantes ne reviennent à la charge, les inscrire, mentalement ou physiquement, sur une liste de choses à faire (to-do list). Une stratégie dont les effets ont été dûment validés par la recherche scientifique», insiste-t-il.
Dans une perspective proche, le psychiatre Christophe André compare la rumination à une inflammation mentale. Utile au départ pour «soigner» un choc, elle peut, à force de persister, se retourner contre nous. Cette dérive guette particulièrement les ruminants solitaires, isolés dans leurs cycles de pensées sans tiers pour les contenir ou les remettre en perspective.
L’âge de raison
Pourtant, des signaux d’espoir existent. Des études montrent qu’avec l’âge, les ruminations tendent à devenir plus constructives: autour de 22 ans, les jeunes adultes ruminent moins leurs angoisses et orientent davantage leur pensée vers des réflexions résolutives. Autrement dit, la maturité émotionnelle permet aussi d’affiner cette mécanique.
Alice, notre enseignante, en a fait l’expérience. En consultant une psychologue, elle a appris à poser un regard différent sur ses pensées.
«Je ne lutte plus contre mes cogitations. Je les écoute, je les nomme, mais je ne me laisse plus entraîner par elles comme avant. Parfois, j’en retire même des pistes pour désamorcer un conflit en classe. Finalement, c’est en leur donnant moins de pouvoir que je suis devenue plus lucide.» Faire la paix avec ses pensées ne signifie donc pas les faire taire, mais réconcilier intention et attention. Un pas décisif vers la troisième étape de ce cheminement intérieur: transformer ses ruminations en ressources.
Pour Andréas, 41 ans, traducteur pour une prestigieuse maison d’édition, la rumination est une compagne fidèle. «Je n’ai jamais été du genre méditatif, confie-t-il. Mon cerveau fonctionne comme une vieille machine à écrire qui recommence sans cesse la même phrase. Parfois, ça m’épuise. Mais d’autres fois, ça produit une fulgurance.» Chaque matin, avant de poser un mot sur son clavier, il nous raconte tourner en rond dans son salon une demi-heure, refaire ses phrases mentalement, ressasser les dialogues. Ce manège, qui pourrait passer pour une perte de temps, est en réalité son sas créatif. «C’est quand j’arrête de vouloir penser juste que l’idée surgit. J’ai appris à ne pas la forcer, à la laisser venir. Et souvent, elle vient quand je crois que je n’y pense plus.»
Des rêveries éveillées
Cette expérience, de nombreux artistes, chercheurs ou thérapeutes la connaissent: ruminer n’est pas toujours subir, cela peut aussi préparer, affiner, mûrir. C’est ce que montrent plusieurs recherches récentes sur les vertus inattendues de ce vagabondage mental. Les psychologues parlent d’incubation créative: lorsqu’un problème résiste à une solution rationnelle, faire une pause et laisser l’esprit divaguer active des zones cérébrales propices à des connexions inattendues.
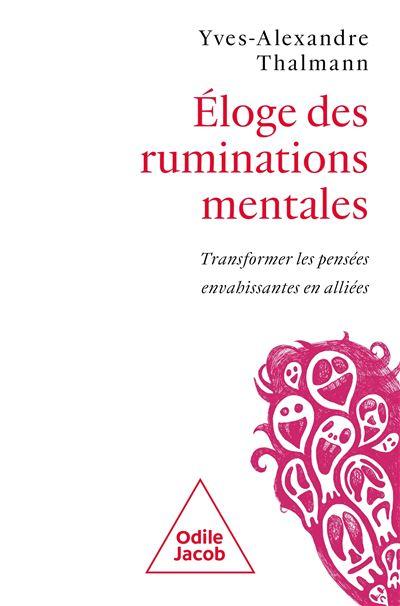
Le fameux «Eurêka», loin d’être une illumination soudaine, serait souvent le fruit d’un long brassage intérieur. «Lorsque notre attention n’est pas focalisée, des circuits neuronaux spécifiques se mettent en action. Cette activité autonome est essentielle à la mise en réseau de l’information, que ce soit pour la mémorisation, la compréhension ou la créativité», confirme Yves-Alexandre Thalmann.
La rumination digère les chocs et aide à refaire sens après l’épreuve.
Ce réseau neuronal, baptisé «mode par défaut», s’active notamment sous la douche, en marchant ou juste avant de s’endormir, ces moments où, libérés des sollicitations extérieures, nous plongeons dans nos pensées. Ces rêveries éveillées, loin de nous distraire, jouent un rôle crucial dans la pensée flexible et imaginative. C’est aussi là que s’élaborent, à bas bruit, des pistes de résolution pour des conflits ou des impasses affectives.
Ni tare, ni miracle
Mais la rumination n’alimente pas que la création: elle digère aussi les chocs, aide à refaire sens après l’épreuve. La psychologie parle ici de «rumination délibérée», cette reprise volontaire d’un événement douloureux, non pas pour s’y enliser, mais pour tenter de l’intégrer. Les chercheurs qui ont suivi des étudiants confrontés à la pandémie de Covid-19 ont ainsi observé que ceux qui s’étaient donné le temps de repenser consciemment à l’expérience montraient une meilleure capacité de rebond. Leur rumination, loin d’être un poids, devenait un levier de croissance post-traumatique.
Ce phénomène, Yves-Alexandre Thalmann le décrit comme un usage «stratégique» de nos cogitations. «Notre capacité à nous extraire de l’instant présent pour repenser à des problèmes en suspens est sans doute un aboutissement de l’évolution de notre cerveau, à la clé de notre formidable capacité d’adaptation.» Pour lui, le secret est de passer à une rumination choisie, orientée.
Ni tare, ni miracle, la rumination se révèle, au fil des témoignages et des recherches, comme un mouvement intérieur ambivalent, parfois pesant, souvent fécond. Elle peut ralentir, encombrer, mais aussi éclairer, approfondir. À condition d’en comprendre la logique, de l’écouter sans forcément la suivre, et peut-être de lui accorder un peu moins d’hostilité. Dans un monde qui valorise la rapidité, l’oubli ou la distraction, il n’est pas inutile de rappeler qu’il est parfois salutaire… de revenir sur ses pas.
Éloge des ruminations mentales, par Yves-Alexandre Thalmann, éditions Odile Jacob.