Mariam Sy est malienne et a étudié l’architecture à Bruxelles, à l’Institut Victor Horta, de 1999 à 2004. » Je suis arrivée par hasard en Belgique, car ma soeur y vivait. Quand j’ai débarqué, il faisait froid, c’était horrible… « , raconte-t-elle dans un éclat de rire. Aujourd’hui, elle est à la tête d’un bureau d’une dizaine de personnes, à Bamako. Rencontre.
Après vos études, vous êtes directement retournée en Afrique ?
Oui, pour y faire mes stages. Mais je me suis prise de passion pour l’architecture en terre et je suis repartie à Grenoble pour suivre une formation sur le sujet. Ensuite, je suis rentrée au Mali et j’ai eu l’opportunité de travailler sur des projets de patrimoine durant deux ans. En 2008, je suis revenue dans la capitale, Bamako, et j’y ai créé mon cabinet, avec des hauts et des bas, dans un contexte africain où j’ai dû m’adapter à la façon de construire.
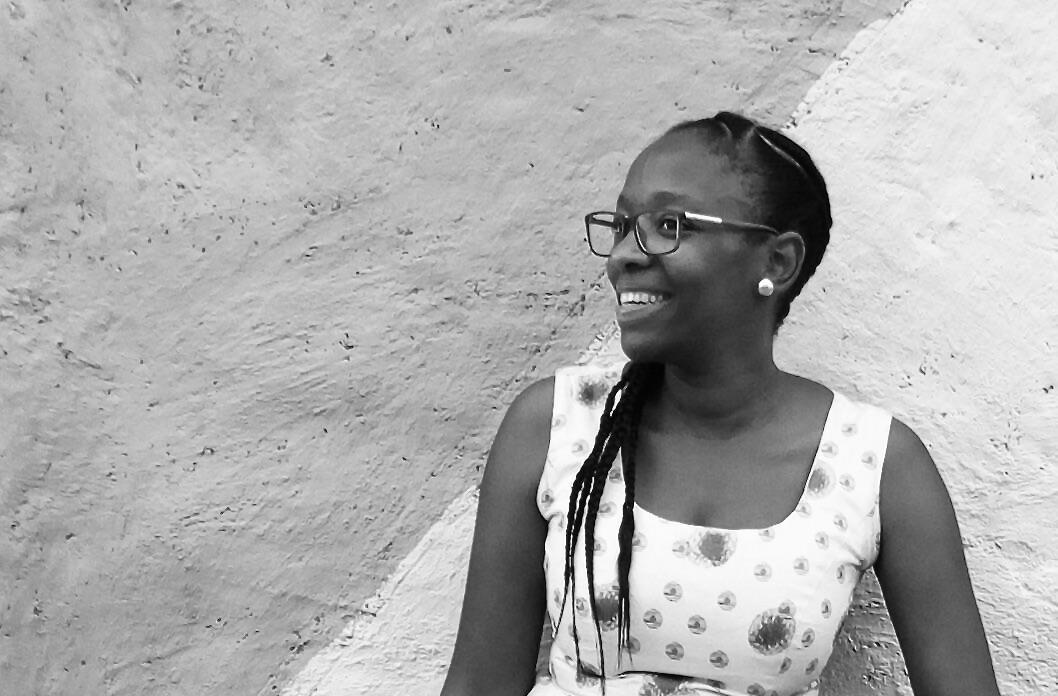
C’est-à-dire…
J’ai appris l’architecture en Belgique, mais c’est sur le terrain que j’ai vraiment intégré le métier d’architecte. Avant, j’étais plus intéressée par le moderne et les nouvelles constructions mais le fait de travailler sur des chantiers de restauration, de côtoyer des vieux maçons, des gens qui utilisaient ces bâtiments depuis des décennies, m’a fait prendre conscience que les solutions à une question d’architecture n’étaient pas uniques, qu’il fallait trouver des solutions localement. Ça m’a donné une autre vision de l’architecture. Et ça a guidé le reste de mon chemin.
C’est pour cette raison que vous vous êtes orientées vers l’architecture en terre ?
En effet, mais j’ai vite découvert que je ne pouvais pas me limiter à ça au Mali, contrairement à la Belgique où certains architectes sont spécialisés dans un secteur de niche. Ici, les textes de loi, inspirés de l’Occident évidemment, imposent la signature d’un architecte pour les projets résidentiels et plus grands. Mais pour les gens, c’est seulement une contrainte administrative. Le public qui fait appel à un architecte est restreint. On ne peut donc pas se mettre dans un secteur pointu et en vivre. Par ailleurs, la plupart des Maliens ne font pas la différence entre ingénieur et architecte. Seuls ceux qui sont très éduqués ou en lien direct avec ces professions font la part des choses et cela génère des conflits pour savoir qui peut ou doit agir.
Est-ce que le rôle de l’architecte évolue quand même au Mali ?

Oui, je vois vraiment un changement et c’est ce que j’essaye de faire passer. Quand je suis arrivée en 2006, sur une centaine d’architectes, j’étais la troisième ou quatrième femme, alors qu’aujourd’hui, on est plus de 200 à pratiquer ce métier dont une cinquantaine de femmes, je pense. Les gens commencent lentement à voir la différence entre les maisons conçues ou non par les architectes. Mais ça reste encore très citadin comme démarche. Il faut aussi que les autorités aillent plus loin que ces textes basiques et qu’ils intègrent les architectes à tous les niveaux. Ça, c’est vraiment une grosse différence entre ce que j’ai appris à l’école et ce que je vis sur le terrain. Mais je me suis adaptée… comme les anciens l’ont fait avant moi.
Et en tant que femme, est-ce compliqué ?
En Belgique, je n’ai jamais vu de différence entre hommes et femmes ; j’avais l’impression qu’on était même plus de filles aux études. Mais quand je suis revenue au Mali, je me suis dit que ce n’était pas vraiment un métier où les femmes étaient représentées. Les codes, les conversations et les réunions sont très masculines. Dans notre contexte africain, en tant que femme, si on veut se faire respecter, il faut en faire plus que les hommes et avoir un caractère assez fort pour montrer qu’on est d’abord architecte. Pour moi cependant, je ne sais pas si ça a été vraiment difficile car j’y étais préparée : j’ai une mère qui a travaillé dans un domaine d’hommes et je savais à quoi m’attendre.

Avec le recul, est-ce que ce diplôme européen vous a été utile ?
A l’époque, je n’ai pas eu le choix car il n’y avait pas d’école d’architecture au Mali. Il n’y en a une que depuis quelques années. Mais je vis ça comme un avantage d’avoir pu faire mes études à l’étranger, notamment par rapport à l’ouverture d’esprit car j’ai appris plein de choses sur d’autres cultures et une manière plus internationale d’appréhender ce métier. En rentrant au Mali, je me suis sentie armée pour affronter la vie professionnelle. A l’université, on apprend à apprendre, à chercher, à trouver des clés pour comprendre. Et j’ai été chercher moi-même ce qu’il faut savoir pour exercer mon métier au Mali.
La diversité était-elle présente dans vos études en Belgique ?
Je dirais que oui, dans tous les cas, on nous ouvrait les yeux sur le monde. J’étais tout le temps fourrée dans la bibliothèque et c’est la bibliothécaire qui m’a invitée à m’intéresser à l’architecture traditionnelle malienne. Quand j’étais lycéenne, je rêvais de grande architecture internationale en Amérique, en Nouvelle-Zélande… Je me disais que c’était grand et magnifique. Ma formation à Bruxelles m’a finalement fait découvrir mes racines : j’ai appris qu’il y avait, dans mon pays, des choses intéressantes architecturalement parlant.
Aujourd’hui, vous essayez de faire passer ce message chez vous aussi…
Même si ma pratique est diversifiée, je m’oblige à faire une ou deux fois par an un projet en lien avec la terre, les matériaux locaux, car je milite pour l’association Fact Sahel — active dans tout le Sahel (Niger, Sénégal, Tchad, Mali…) — qui revendique que ces techniques deviennent la norme au Mali et entrent dans les cultures constructives modernes et urbaines. Nous sommes convaincus que ce sera un passage obligé, d’un point de vue environnemental, quand on n’aura moins de ressources dans quelques années. L’architecture qu’on promeut actuellement au Mali est basée sur ce qui se fait à l’international, alors que chaque pays a son climat, ses matériaux, sa façon de vivre.

La réflexion environnementale n’est pas encore en marche ?
Non et c’est pour ça qu’on se bat. Quand on arrive avec ces idées écologiques, les gens pensent qu’on veut leur imposer des histoires de Blancs. Certains ne croient pas au réchauffement climatique. Mais on essaye de trouver des mots pour les convaincre. On leur explique que quand ils vont voir leurs parents au village, ils constatent d’eux-mêmes que les maisons traditionnelles sont moins chaudes, plus confortables, alors qu’il n’y a pas d’air conditionné. Qu’est ce qui empêche de prendre ce qui est bien dans cette architecture et de l’adapter aux besoins d’aujourd’hui ? J’ai construit ma maison avec des grandes baies vitrées, des WC suspendus et un design contemporain… mais en terre. Ça permet d’apporter des preuves. Les gens me disent : » On pensait que tu te construisais une case, mais apparemment ça peut fonctionner ! » Les lignes bougent un tout petit peu, mais c’est lent et difficile.
En termes d’urbanisme, quelle est la situation ?
Il y a beaucoup plus de libertés comparativement aux contraintes en Belgique. Il existe des règles mais au niveau du sol, des limites de propriétés. Rien n’est codifié concernant les façades, les volumes… On va devoir y passer, car parfois, on se retrouve avec des choses qui n’ont rien à voir l’une à côté de l’autre.
Est-ce qu’on en arrive à une course à la surenchère comme on la voit dans les pays du Golfe par exemple, où on construit à tour de bras ?
On n’a pas les mêmes moyens mais oui, le prix du foncier a explosé ces 20 dernières années. Tout le monde veut être en ville, au même endroit, la circulation devient catastrophique. Comme dans les autres grandes métropoles d’Afrique, à Bamako, on est dans des logiques de quartiers-dortoirs : les gens vivent à des kilomètres du centre, viennent tout dégueulasser la journée et repartent. On a vraiment de moins en moins d’espaces verts, on coupe les arbres, on n’a plus de place pour des aires de jeux, des parcs. Les maires vendent tout ce qu’ils peuvent.
C’est aussi l’un de vos combats ?
Je me suis dit que si, en tant qu’architecte, j’intégrais un peu le monde de la promotion immobilière, je pourrais montrer l’exemple. Je travaille avec une société de promotion pour concevoir des cités. Avant, elle reproduisait des blocs à l’infini. Maintenant, nous essayons de respecter le mieux possible l’environnement existant. On construit des centaines de maisons, où les gens se sentent bien. C’est en ville, mais dans un cadre boisé. Je veux montrer qu’on peut aussi se faire de l’argent en se préoccupant de la qualité d’habitat, et ne pas se limiter à des cages à poules, des blocs de ciment, avec deux ou trois fenêtres par-ci par-là.
Avec le recul, quel regard portez-vous sur ce qui se fait en Europe ?
Les cinq premières années, je me disais que j’étais en train de désapprendre ; je voyais mes collègues d’Horta qui travaillaient avec des nouvelles technologies. J’avais peur de m’enfermer au Mali. J’essayais de voyager, de me mettre à niveau par rapport à l’Occident. Mais aujourd’hui, j’ai tellement d’objectifs d’adaptation au niveau local que je ne suis même plus ce qui se passe en Belgique. Ma soeur s’est mariée avec un architecte belge, je continue à venir les voir, ainsi que mes camarades de classe qui sont étonnés de voir l’étendue des projets que je peux développer dans mon pays. Eux ne sont pas habitués à pouvoir gérer des missions d’un bout à l’autre dans leurs bureaux. Ils sont souvent impressionnés.
a-architerre.com et factsahelplus.com

