Ils se font plutôt rares, les architectes belges issus de l’immigration. Huit d’entre eux se confient sur les défis du secteur, leur amour pour l’art de bâtir, et la discrimination, qu’elle soit positive ou négative.
« Venir d’ailleurs n’empêche pas de pouvoir s’exprimer. »
Né à Beyrouth, Frédéric Karam (38 ans) a ensuite habité Paris, puis fait ses études en Suisse avant de s’installer à Bruxelles. Avec succès, puisque ses projets se sont fait remarquer dans des concours (Build Architecture Awards, Building of the Year) et qu’il présentera une installation à la Biennale de Venise cette année.

« Mes parents sont architectes. Les plans, les discussions sur le mobilier ou l’immobilier, ça a toujours fait partie de mon environnement. J’ai grandi dans les chantiers. J’ai aussi vécu une partie de mon enfance dans le Liban en guerre, j’ai assisté à la destruction de Beyrouth. Donc très vite, la question de l’archi m’a intéressé – mais j’ai d’abord commencé des études d’informatique, parce que ça m’attirait et par esprit de contradiction envers mes parents (rires). A la base, je suis venu à Bruxelles pour un projet d’un mois… Ça fait treize ou quatorze ans que je suis ici. Dans cette ville, on ressent une tolérance à la diversité, venir d’ailleurs n’empêche pas de s’exprimer, on peut vite s’y retrouver sans être belge. Ça permet d’être constructif: ce qui compte, c’est le résultat, pas la manière d’y arriver. Il y a une dynamique qui nous pousse à aller de l’avant. Je pense que le pays a toujours été ouvert à travailler avec n’importe qui, pour peu qu’il sache ce qu’il fait. Le côté éclectique, la débrouille et la recherche de solutions, c’est la force de la Belgique. Quand on me demande pourquoi je suis venu ici, je réponds que c’est le parfait milieu entre le chaos libanais et l’organisation suisse. »
« Avec mon nom, ça se remarquait beaucoup plus vite quand je n’étais pas là. »
A 12 ans, l’Anversois Fouad El Idrissi (43 ans) savait déjà avec certitude quel métier il exercerait plus tard. Il fut le premier architecte flamand marocain diplômé de l’Institut Henry Van de Velde.
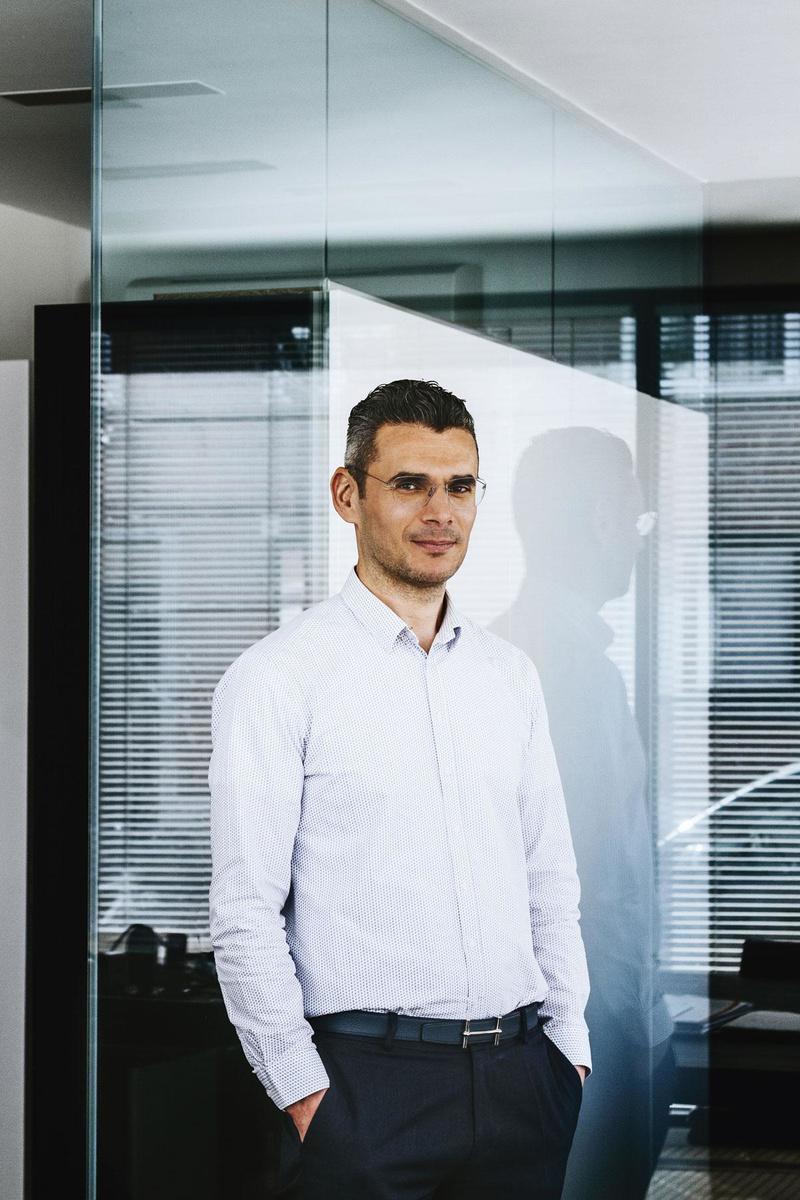
« En sixième primaire, mon instituteur me mit un livre entre les mains: L’architecture du XXe siècle. Ces bâtiments futuristes de Le Corbusier et Mies van der Rohe notamment furent une révélation. J’ai choisi une école secondaire où j’avais la possibilité d’opter pour la conception architecturale en 2e année et j’ai tout fait pour y arriver.
L’Institut Henry Van de Velde était la seule école à Anvers à proposer une formation académique en architecture. A la fin de ma 1ère année, je me suis retrouvé avec sept examens de passage, c’est pourquoi j’ai hésité à abandonner. Heureusement, j’ai persévéré et je suis devenu bien plus appliqué. Plus j’avançais, moins il y avait d’étudiants et plus le nom El Idrissi sortait du lot. J’avais l’impression que ça se remarquait beaucoup plus vite quand je n’étais pas là, ce qui me poussait naturellement à faire plus d’efforts. Je pense bien que cela m’a rendu plus fort.
En 2000, je fus diplômé avec distinction. J’ai pu réaliser mon stage chez un architecte qui vivait en face de chez mes parents. J’ai ensuite travaillé une courte période dans un cabinet d’architectes à Kapellen, ainsi que chez feu Jo Crepain. Après quatre belles années, j’ai créé mon propre bureau. Depuis, la plupart de mes clients me contactent grâce au bouche-à-oreille, y compris des Belges marocains, pour la simple et bonne raison que je parle leur langue mais aussi pour l’aspect culturel. L’ancienne génération ne parle pas très bien le néerlandais, ce qui facilite la communication avec moi. Dans la pratique, ce n’est pas le facteur le plus décisif, mais il contribue à une bonne entente.
En 2018, j’ai gagné un Diwan Award. Il s’agit d’une association belgo-marocaine qui met en lumière les personnes qui ont oeuvré pour la communauté. Je pense bien que je suis toujours le seul architecte d’origine marocaine à Anvers. Dans ma communauté, on se tourne souvent vers des professions plus sûres, comme avocat ou médecin. La combinaison entre la créativité et la théorie rend peut-être la formation en architecture moins attrayante. Néanmoins, j’adorerais qu’il y ait plus d’architectes aux origines variées. Un peu de compétition permet de continuer à s’améliorer. »
« Je trouve que les quotas sont à double tranchant. »
Asli Çiçek (43 ans) a quitté sa Turquie natale pour étudier en Europe. Désormais, elle combine les professions de scénographe, professeure et architecte d’intérieur, dans notre capitale.

« Toute ma vie, j’ai été entourée par l’architecture. Ma mère comme mon père étaient dans le domaine: mon papa tenait plusieurs bureaux déjà bien avant ma naissance et donnait des cours à l’Académie des beaux-arts et de l’architecture à Istanbul. Quant à ma maman, elle a très longtemps travaillé pour une entreprise de construction avant d’enseigner à l’université. Les week-ends, mon père m’emmenait sur des chantiers, ou alors nous dessinions des plans ensemble. Et puis, j’ai dû me charger de la végétation sur les balcons. En réalité, l’architecture planait toujours sur la maison. Pourtant, ma mère trouvait cela dommage que je m’oriente dans cette direction moi aussi. Deux sots dans la famille, c’est bien assez, disait-elle (rires). Je me souviens également d’une discussion avec mon père, lorsque j’avais 16 ans. Il m’a raconté que je devrais travailler dur toute ma vie. « Mais une fois que tu seras entre les quatre murs que tu as toi-même dessinés, tu ne voudras plus jamais t’arrêter », m’a-t-il prévenu.
Après mes secondaires, je désirais partir à l’étranger. Puisque j’avais étudié dans une école germanophone depuis mes 11 ans, j’ai passé l’examen d’entrée pour l’Académie des Arts de Munich. Mon visa expira juste au moment où je fus diplômée. Entre-temps, j’avais rencontré mon ex-conjoint, un Belge habitant à Rotterdam et je suis partie vivre là. Deux ans plus tard, je décrochais un job dans un bureau bruxellois, j’ai donc déménagé ici.
En 2007, j’ai pu commencer à travailler comme assistante chez Robbrecht & Daem. Ainsi, j’ai bossé en étroite collaboration avec Paul et Hilde, principalement sur des projets d’intérieurs, mais aussi sur des concours et des expositions de design urbain. C’est là que j’ai reçu ma deuxième formation. Et grâce à ce boulot, j’ai redécouvert mon amour pour l’architecture d’intérieur. Entre-temps, j’ai également commencé à enseigner à Sint-Lukas et à la KULeuven. En 2014, j’ai fondé ma propre agence lorsque j’ai été contactée par le festival Europalia pour préparer deux expositions sur la Turquie à Bozar. C’était le moment ou jamais, je le savais, alors j’ai décidé de foncer. En tant que scénographe, mon travail consiste à traduire en termes architecturaux la démarche des commissaires. Plus tard, ils m’ont à nouveau sollicitée pour une exposition sur l’Indonésie et sur l’artiste Constantin Brâncu?i, ce qui m’a permis d’élargir mon portefeuille en très peu de temps.
Je trouve que les quotas sont à double tranchant. Je suis de plus en plus sollicitée pour des jurys et des postes vacants, car je coche de nombreuses cases: je suis une jeune femme, j’ai mon cabinet, j’écris, j’enseigne et je suis issue de l’immigration. Au bout d’un moment, vous ne savez plus si l’on vous demande votre avis en raison de votre profil ou de vos réalisations. J’espère néanmoins que le fait d’être dans une classe peut être une source d’inspiration pour les jeunes qui ont des racines étrangères. Je suis convaincue que la diversité ne peut être qu’enrichissante. Dans tous les domaines, et pas seulement en termes d’ethnicité. »
« Je n’ai encore jamais été dans une position de revendication. »
Né au Congo d’un couple mixte, Johnny Leya (30 ans) aura pas mal bourlingué avant de se poser en région bruxelloise. Avec le studio Traumnovelle, qu’il a cofondé avec sa partenaire Léone Drapeaud et son ami Manuel León Fanjul, il a représenté la Belgique lors de la dernière Biennale de Venise.

« Tout petit, je rêvais d’être à la tête d’une compagnie d’aviation, parce que mes parents voyageaient beaucoup. Puis, vers 10 ans, j’ai su que je voulais devenir architecte. L’architecture s’est imposée, sur la base d’un constat assez simple: je sentais que l’espace autour de moi ne me convenait pas, peut-être que tout ce mouvement, toutes ces différentes reculturations m’ont donné envie de le changer, pour qu’il puisse me convenir un peu plus.
En Afrique, j’étais « le Blanc », et en arrivant ici, je suis devenu noir. En tant que métisse, tu sais que tu vas de toute façon être discriminé, au moins être mis dans une case ou dans l’autre. Pour moi, c’était comme un cadre de base dans lequel évoluer. Les questions sur l’identité m’accompagnent depuis le début, mais j’aurais du mal à les rattacher à mon métier d’architecte. Peut-être que l’on peut faire le lien avec ce besoin de « construire sa propre maison », mais je n’ai pas encore poussé la réflexion sur les rapports entre mon identité et l’architecture.
Je savais que la question de la diverstié était plus présente dans notre métier ailleurs, grâce à des amis d’Angleterre ou des Etats-Unis — pas étonnant qu’on rapatrie toujours des théories anglo-saxonnes, au vu du travail d’étude et de représentation qui a déjà été fait par les communautés locales. Mais bizarrement, jusqu’il y a quelques mois, pour moi, ce n’était pas une question, juste un constat: oui, j’étais le seul élève noir de ma promotion. Oui, à la Biennale de Venise, ça ne débordait pas de diversité. Etc, etc. Je trouve important qu’on puisse en parler dans les médias. C’est un thème difficile à traiter, mais il est temps d’en faire un sujet. Et comme le travail doit commencer quelque part, posons-nous des questions: où est la diversité? Qu’est-ce qu’il est en train de se passer?
Le champ de l’architecture se nourrit à la fois du passé et de nouvelles histoires, mais aussi d’exemples et de modèles — moi je ne cherche pas à être un modèle par défaut, mais ce serait bien que l’on fasse d’autres représentations. On prétend parfois que la discipline est fermée aux autres cultures, aux échanges, qu’il y règne la pensée unique, mais c’est complètement faux — je suis bien placé pour savoir que cette vision « unique » ne tient pas la route. Et pourtant, je n’ai jamais encore été dans une position de revendication, enfin peut-être que je commence à l’être et que je le serai encore plus à l’avenir. Il y a une telle absence de discours, d’ouverture, de débats, qu’à un moment, le simple fait de poser des questions devient une revendication. »
« La quête continue d’une identité est une richesse. »
A la tête d’une équipe particulièrement multiculturelle à Bruxelles, Movses Der Kevorkian (39 ans) vient de rentrer d’Arménie, où il a donné des conférences et participé à un projet de relogement des victimes de guerre.

« Ces notions de diversité et de double appartenance, je les cultive depuis ma naissance: je suis Arménien du Liban, j’ai donc toujours fait partie d’une minorité. A mon arrivée en Belgique, cette sensation s’est prolongée et ça ne me dérange pas: c’est une richesse, la quête infinie et continue d’une identité à la fois nationale et humaine. Au Liban, la multiculturalité est une richesse au niveau social; au niveau politique, ça n’aboutit généralement qu’à un blocage. Ici, l’approche institutionnelle est plus sérieuse, le cadre étatique du pays participe au processus d’intégration, le brassage profite d’une coordination officielle et porte ses fruits. Voir cette diversité se réunir et obtenir des succès montre que la vraie collaboration et la vraie coordination passent au-delà des différences d’approche ou de mentalité. Un de nos plus beaux projets a été mené à bien par quatre composantes assez représentatives de cette diversité: un architecte arménien libanais, un maître d’ouvrage italien, un entrepreneur marocain et la commune de Molenbeek. Cela prouve que l’archi est la résultante du « comment vivre ensemble? ». Ça restera toujours la question majeure. La recherche d’un terrain d’entente, d’un dénominateur commun, dépasse le cadre de cette discipline et concerne toutes les professions. »
« Des profs me demandaient pourquoi il y avait si peu d’étudiants issus de l’immigration en archi. »
Il y a un an et demi, Rukiye Karanfil (36 ans) a troqué son bureau d’architecte contre un autre boulot et un nouveau départ.

« Puisque mes parents n’ont jamais pu faire de hautes études, ils nous répétaient toujours que les choses seraient différentes pour nous. Quand j’étais enfant, je notais dans les carnets d’amitié que mon rêve était de devenir architecte. Bien sûr, quelques fois, ça se transformait en pilote, mais ça c’était avant tous les problèmes de la Sabena (rires). Durant ma première année à Sint-Lukas, j’ai remarqué que mes connaissances en matière de culture et d’architecture étaient limitées. Nombre d’élèves étaient des enfants d’architectes et possédaient un fameux bagage, ce qui créait un certain fossé. Dès lors, j’ai passé de nombreuses heures à la bibliothèque. Grâce à cela, dès la 3e année, je pouvais imaginer des concepts différents plus rapidement que n’importe lequel de mes camarades. Dans mon année, il y avait peu de diversité et j’ai ressenti une certaine discrimination positive. Les professeurs au caractère plus difficile m’ont bien traitée et se sont intéressés à mes origines turques. On m’a même abordée et demandé pourquoi il y avait si peu d’étudiants issus de l’immigration. Entre-temps, j’ai participé à la création d’une association d’étudiants pour montrer que la poursuite des études était possible.
Après mon stage, j’ai postulé à cinq postes, pour lesquels j’ai reçu quatre réponses positives. J’ai choisi le bureau anversois B-architecten, où j’ai travaillé pendant deux ans, jusqu’à ce que le trajet entre Gand et Anvers devienne trop pénible. J’avais 30 ans et je pensais que c’était un bon âge pour me lancer dans autre chose. Je voulais devenir indépendante et faire le lien entre les bureaux belges et les projets de construction en Turquie. Mais malheureusement je n’ai pas trouvé les bons partenaires. A l’époque, j’avais quelques projets de rénovation en cours en Belgique et, grâce à un réseau d’entrepreneurs turcs, j’ai gagné plusieurs clients et réalisé une multitude de projets.
En décembre 2019, j’ai démissionné car je n’en pouvais plus de tout le travail administratif. Depuis septembre, je travaille dans une entreprise de construction, où je chiffre des dossiers d’appel d’offres et j’ai retrouvé ma tranquillité d’esprit. J’ai l’intention de continuer l’architecture comme un hobby. Je vais peut-être enfin pouvoir commencer à dessiner ma maison de vacances de rêve en Turquie… »
« Il y a toujours bien une petite règle à laquelle un dossier de construction ne se conforme pas. »
Presque directement après ses études, Ismaël Gielen (41 ans) a monté son propre bureau. Aujourd’hui, il conçoit des bâtiments commerciaux ainsi que des projets résidentiels innovants sous le nom de R2Livin+ Group. En prime, il donne cours aux futurs chefs de chantier à la haute école PXL.

« J’ai réussi mes études à PXL Diepenbeek presque sans effort. C’était une période agréable qui contrastait fortement avec mes expériences des secondaires. La scolarité, le fait de devoir respecter les règles, de 8 h 30 à 17 heures, etc. m’ont dégoûté de l’école lorsque je suis arrivé en 5e année. J’ai tout de même obtenu des notes correctes, mais je n’ai fait que le strict nécessaire, ce qui n’a pas plu à une prof en particulier, qui a fait en sorte que je redouble. C’était la toute première fois que je remarquais que mes origines marocaines avaient joué un rôle dans cette décision. Cela m’a amené à perdre confiance envers les autres et à adopter une attitude très défensive vis-à-vis de mon entourage. En revanche, l’université fut une révélation. J’y ai éprouvé beaucoup plus de liberté, d’ouverture et de possibilités de dialogue. Et puis, j’y ai rencontré mon âme soeur et associé, Leander Kippers.
Au cours de mon stage, j’ai appris l’importance du travail acharné, et lorsque j’ai créé mon propre bureau, j’ai poursuivi sur cette voie. Au début, je travaillais surtout par le biais de mon réseau au sein de la communauté marocaine, mais au bout d’un temps, je traitais une cinquantaine de dossiers par an à prix d’ami. Après la crise de 2008, Leander et moi nous sommes demandé comment le secteur de l’architecture allait évoluer. D’une part, les maisons unifamiliales sont de plus en plus difficiles à payer. D’autre part, les promoteurs sont plus susceptibles de construire sur l’ensemble du terrain. Pour garder le cap, nous avons décidé de nous spécialiser dans la conception de projets B2B (business to business) à haute technicité ainsi que dans la construction de villas haut de gamme.
En prime, depuis onze ans, j’enseigne également aux étudiants du bachelier en construction à la haute école PXL. De mon temps, seuls deux de mes camarades étaient d’une autre origine. Aujourd’hui, les choses ont bien changé et les classes sont plus représentatives de la société. Les jeunes Turcs, en particulier, se tournent vers les hautes écoles car ils ont un plus grand soutien de leur famille. Par contre, la proportion de garçons marocains dans mes cours reste minime, quant aux filles, elles se dirigent rarement vers notre programme. Par ailleurs, nous constatons fréquemment que ces garçons accusent un retard en termes de connaissances et de langue, ce qui les démotive au bout d’un certain temps. Pourtant, il y a tellement d’opportunités. Mais en général, les jeunes préfèrent éviter le défi plutôt que la déception.
Existe-t-il encore des discriminations sur le marché du travail? Même si j’ai le nom de famille de ma mère belge, dans la structure actuelle de notre entreprise, je m’occupe moins des contacts avec les autorités. Je me concentre davantage sur les chantiers et la mise en oeuvre, où l’on est jugé sur ses connaissances et non sur ses origines. Nous constatons qu’il est plus difficile de faire passer des dossiers avec des noms exotiques auprès des administrations. Il y a toujours bien une petite règle à laquelle un dossier de construction ne se conforme pas, mais on fait avec (rires). »
« Un professeur m’a dit que je ferais mieux de m’inscrire en esthétique. »
Plus d’un an, c’est le temps qu’a mis Havvagül Varol (26 ans), fraîchement diplômée, pour trouver un lieu de stage. En mars, elle l’a commencé finalement au bureau anversois DWYD Architecture.

« La première fois qu’on a douté de moi, c’était à l’école secondaire. Avant ça, en primaire, j’étais toujours la première de classe, mais à l’adolescence, je n’avais plus toujours envie d’étudier. Ainsi, mes points ont commencé à chuter. Un professeur m’a alors dit que je n’étais pas faite pour l’enseignement général et que je ferais mieux de m’inscrire en esthétique. Bien évidemment, cette voie ne m’intéressait absolument pas. Je ne comprenais pas pourquoi, et je suis donc restée.
Il est difficile de déterminer si de tels incidents ont quelque chose à voir avec vos origines. Au bout d’un moment, vous devenez parano. Pourtant, mes capacités semblaient être remises en question bien plus souvent que celles de mes camarades, simplement parce que mes parents sont d’origine turque. A la fin de mes humanités, on m’a dit que je ne serais pas capable de faire des études universitaires et on m’a recommandé un graduat. Je voulais prouver le contraire, et mes parents m’ont beaucoup soutenue tout au long de mes études.
Sur le campus, je faisais partie de la minorité. En 1ère année, il y avait une dizaine d’étudiants issus de la diversité. Tandis qu’en 2e, il n’y avait plus qu’un seul garçon turc. De ce fait, j’avais beaucoup moins de contacts à l’école. Par exemple, lorsqu’on devait travailler en groupe, j’avais l’impression que les autres ne venaient pas rapidement vers moi. Sans parler de la recherche d’un lieu de stage qui fut tout aussi difficile. J’ai envoyé tant de mails pour lesquels je n’ai jamais reçu de réponse. Au départ, j’ai même fait exprès de ne pas mettre ma photo sur mon CV parce que certaines personnes ont tendance à changer d’attitude lorsqu’elles voient une femme voilée. J’espérais qu’ainsi, ils se concentreraient sur mon portfolio. Parfois, je comprenais à l’expression sur leur visage qu’ils ne s’attendaient pas à voir ça. On me posait des questions bizarres, comme « que pensez-vous d’Erdogan? », qu’est-ce que cela a à voir avec mon travail? Ou « Que pense votre père du fait que vous allez travailler dans un monde d’hommes comme celui-là? » Mon père sait que je veux être architecte. En fait, il m’a toujours encouragée.
Sans le soutien de mes parents, j’aurais sans doute abandonné. Après plus d’un an, j’ai finalement trouver un lieu de stage au sein d’un bureau anversois, DWYD Architecture. Je suis très heureuse d’avoir atterri ici. Lorsque mon stage sera approuvé par l’Ordre dans deux ans, je pourrai peut-être ouvrir mon propre bureau. Mais je pense que c’est encore trop tôt, je dois encore acquérir beaucoup d’expérience, même si j’espère avoir un jour le courage de lancer ma propre boîte.
Après toutes les démotivations et les personnes qui ne croyaient pas en moi, j’y suis parvenue. Parfois, j’aimerais montrer à ces gens où je suis maintenant. Alors voilà: bisous! (rires) »
