La liste des accusations pesant sur la mode ne cesse de s’allonger. L’historienne de l’art Audrey Millet les a couchées sur papier, dans son Livre noir. Elle y analyse la création, la production et la manipulation propres à cette industrie. Un consommateur averti, une consommatrice avertie en vaut deux.
Elle est longue, la liste des accusations qui pèsent sur la mode et son industrie: racisme, sexisme, jeunisme, grossophobie, stéréotypes de genre, relations de classe et de pouvoir inégales, exploitation jusqu’à la mort d’enfants, de femmes et d’hommes, manipulation des consommateurs, règne de l’achat impulsif, image de corps taille zéro et totalement homogénéisé… Ajoutés à tout cela des chiffres qui uppercutent: entre 1960 et 2015, aux Etats-Unis, les déchets textiles ont augmenté de 811%; dans les pays européens les plus riches, chaque personne achète en moyenne 20 kilos de vêtement par an; moins de 1% des textiles et des vêtements sont véritablement recyclés en nouveaux articles; 35,8 millions de personnes vivent dans une forme d’esclavage moderne; au Bangladesh, une ouvrière textile meurt tous les deux jours au travail… N’en jetez plus. Durant quatre ans d’enquête minutieuse, Audrey Millet, historienne de l’art, spécialiste de l’histoire de l’habillement et chercheuse associée au CNRS, a collationné les dysfonctionnements d’une industrie qui tue et pollue. Son Livre noir de la mode est un procès mais aussi un appel aux patrons, entrepreneurs, chercheurs, créateurs, citoyens, « consommacteurs » à la « réhumaniser pour la sauver ».
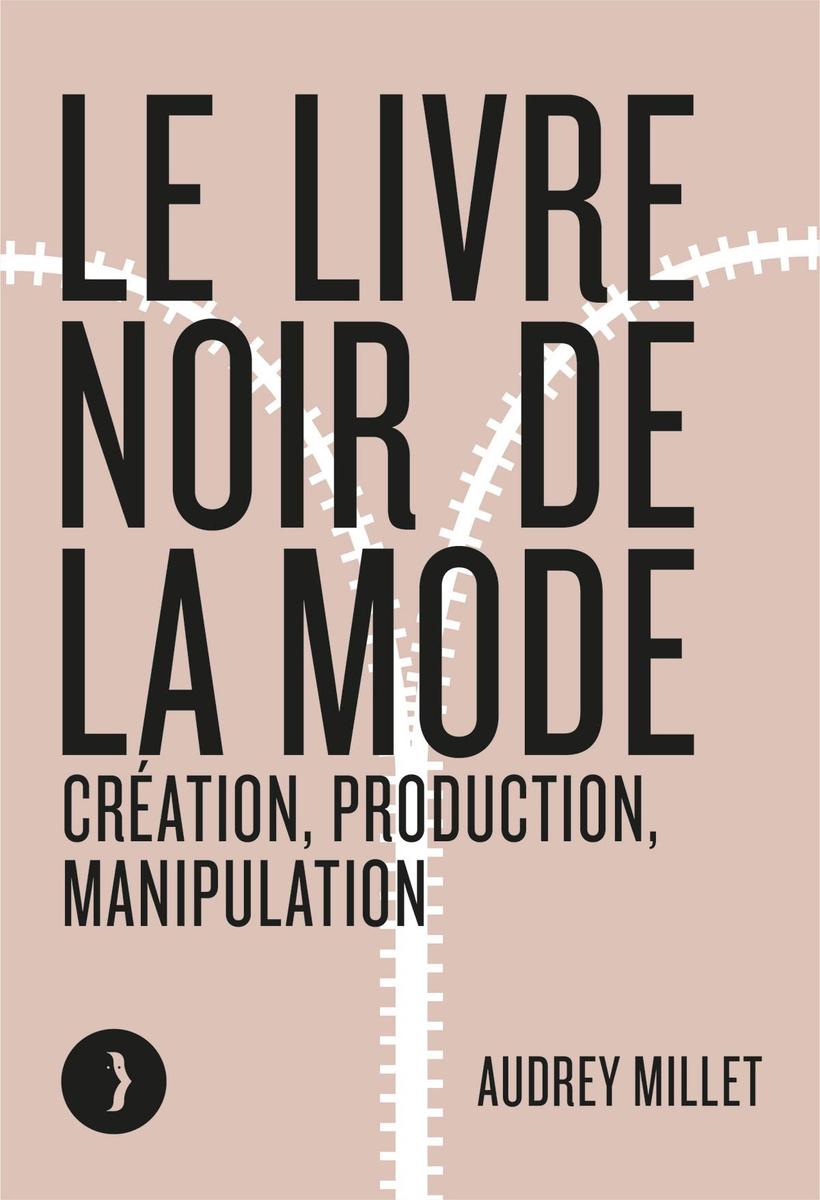
Vous rappelez qu’en quinze ans, la consommation occidentale de vêtements a augmenté de 60% alors que nous les conservons deux fois moins longtemps. La fast fashion est morte, vive l’ultra fast fashion?
En 1905, le sociologue allemand Georg Simmel écrivait déjà ceci dans un texte phare, Philosophie de la mode: « Plus un article est sujet à de rapides changements de mode, plus la demande pour des produits bon marché de ce type est grande. » La fast fashion, ou la mode rapide, techniquement, est une mode qui nous donne des nouveautés toutes les semaines, ou tous les quinze jours. C’est une méthode radicale de vente au détail, détachée de la vente saisonnière, qui crée de nouveaux stocks tout au long de l’année. On la doit à la société espagnole Zara, rapidement copiée par les autres enseignes. L’ultra fast fashion, elle, est encore plus formidable, j’en rigole mais c’est nerveux: elle est encore moins chère que la fast fashion. Un exemple? Le cas de Kylie Jenner, en novembre 2019, qui fêtait ses 21 ans dans une tenue rose fuchsia customisée Yeezy, avant de se glisser le soir venu dans un mini jumpsuit scintillant de Swarovski, réalisé dans les ateliers de la Bourjoisie. A peine 24 heures plus tard, des pièces identiques étaient proposées à la vente, sur le site de la marque californienne Fashion Nova, d’une qualité médiocre et à des prix ridicules. La question qui se pose, c’est combien de centimes vont aller dans la poche des ouvriers de ces entreprises d’ultra fast fashion. Et pourtant, elles ont déjà été épinglées pour l’exploitation de leur main-d’oeuvre souvent payée illégalement et à bas salaire.
Vous démontrez que les ateliers de misère sont toujours d’actualité dans les pays industrialisés…
On pense toujours que la démocratisation de l’habillement date du XXe siècle et de la naissance du prêt-à-porter. Mais c’est faux, elle date du XVIIe siècle lorsque les Anglais et les Français ont commencé à coloniser le monde, on a alors assisté à une accélération de la production. Dans les arrière-cours de Londres et d’Oxford ou de Paris, il y avait plein de petites mains que l’on faisait travailler à la pièce – en réalité, c’est le soubassement de l’industrie du textile. Une série d’améliorations techniques ont alors rendu possible la production à grande échelle. Et l’explosion de la productivité de l’industrie cotonnière anglaise a entraîné une baisse spectaculaire des prix. Une nouvelle classe de consommateurs est apparue. Et quand on a goûté aux cotons chatoyants, facilement lavables et peu coûteux, il n’y a pas de retour en arrière possible. Dans les usines, malgré les avancées sociales, la situation des ouvriers n’était guère plus brillante que dans les arrière-cours. Fin XIXe et début XXe, ce seront les migrants – des Juifs, des Italiens, des Polonais – qui se mettront à coudre. Puis la production s’en est allée en Asie et on a alors pensé qu’il n’y avait plus cette forme d’esclavagisme en Europe. Mais elle existe encore.
Si j’achète une pièce à 1 euro, vais-je la respecter? Et si je ne la respecte pas, est-ce que je me respecte?
La prise de conscience pourrait-elle mettre un frein aux achats impulsifs propres à la fast fashion?
Il faut comprendre que les gens ont des excuses: la crise économique et sociale dure depuis les années 80, on ne peut pas dire que leur vie soit super simple pour se faire plaisir – trois places de cinéma pour gâter ses enfants, cela reste plus cher que trois tee-shirts chez Primark. Il y a une misère des loisirs, ces dimanches où l’on allait au jardin des plantes, cela n’existe plus, on va désormais au centre commercial. Ensuite, on s’est habitué à acheter des produits de moins en moins chers. Regardez sur Vinted, on y trouve des vêtements à un prix hallucinant, 1, 2 ou 3 euros. On peut dès lors se poser également cette question: si j’achète une pièce à 1 euro, vais-je la respecter? Et si je ne la respecte pas, est-ce que je me respecte? L’air de rien, un vêtement, cela habille un corps, c’est votre première armure, et cela sert à ça et c’est tant mieux.

En mars 2020, un rapport de l’Australian Strategic Policy Institute dénonçait le travail forcé dans le Xinjiang de dizaines de milliers d’Ouïghours pour des marques telles que Zara, Uniqlo, Nike ou Adidas. Cela a-t-il fait bouger les lignes?
Pas vraiment. Quatre-vingt-trois marques sont concernées et majoritairement, elles considèrent qu’elles ne sont pas responsables de la sous-traitance de leurs sous-traitants. Pourtant, elles avaient déjà promis d’examiner plus précisément leur chaîne de production après la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh en 2013 et d’en améliorer la transparence. Certes on a un mal fou à obtenir des chiffres, mais on sait que les Ouïghours sont victimes d’une politique d’enfermement, de harcèlement et d’oppression, on sait qu’il y a des camps d’internements, des gens qui ne reviennent jamais, des organes vendus… Le titre de cet article paru sur Consoglobe est clair: « Chine: un produit en coton sur cinq vient d’un camp de travail Ouïghour ». Mais Pékin nie. Derrière tout cela, se pose la question de la production à moindre coût par une main-d’oeuvre esclave. Et sans main-d’oeuvre à moindre coût, pas de tee-shirt à 5 euros…

Vous faites d’ailleurs un rapide calcul qui vous permet d’écrire que le salaire des ouvriers du vêtement pourrait être doublé sans que cela affecte de manière notable le prix de vente…
Oui, puisqu’il ne représente que 1% à 3%. On pourrait doubler le salaire des ouvriers, le prix au détail n’augmenterait jamais que de 1% à 3%. Si on le triplait, il serait de 2% à 6% plus élevé. On estime ainsi que Nike pourrait se permettre de doubler la rémunération de ses 160.000 ouvriers sans augmenter le prix de vente. Et si la marque refuse de réduire sa marge et que l’on double le salaire moyen des ouvriers indiens, par exemple, un tee-shirt à 5 euros devrait être vendu à 5,10 euros. Si on le doublait, il coûterait 5,30 euros. On pourrait même augmenter tous les postes, acheter de la teinture bio notamment, sans grande conséquence sur le prix final d’un produit… Mais ce n’est pas l’intention des actionnaires, qui veulent de la marge. L’entreprise capitaliste ne peut pas soulager la souffrance des travailleurs, ce serait contre-nature: il faut maximiser les profits et satisfaire les actionnaires et les investisseurs en compressant les coûts autant que possible.
Vous dénoncez le marché de la seconde main qui transforme l’Afrique en poubelle de l’Occident et qui ne fait en réalité que « cacher la misère de l’acte d’achat ». Expliquez.
Les Etats-Unis sont le plus grand exportateur de vêtements d’occasion, avec chaque année plus de 500.000 tonnes destinées à une centaine de pays, majoritairement en Afrique. On produit tellement qu’il nous faut un continent poubelle. D’autant que l’on ne sait pas encore recycler correctement, la transformation d’une pièce en un autre matériau, comme des isolants, n’en est actuellement qu’à ses balbutiements. Le problème repose aussi sur l’acte d’achat impulsif: pour 10 euros, avec la seconde main, vous pouvez avoir 10 produits, avec l’ultra fast fashion, 4 et avec la fast fashion, 2… Cela dit, beaucoup de gens préfèrent le neuf. Car la seconde main a toujours mauvaise réputation: il ne faut pas oublier qu’au XVIe siècle, elle fut accusée d’avoir amené la peste noire à Venise. On pointa alors les fripes des bateaux venus d’Orient, les fourrures que portaient les courtisanes, ce n’est sans doute pas entièrement faux. Tout cela est resté dans les imaginaires: « La fripe, c’est sale, ça pue. »

Qu’avez-vous découvert lors de vos quatre années d’enquête sur cette industrie « à bout de souffle qui meurt et nous tue »?
L’empoisonnement continu des corps. Les gens ont l’impression que, puisqu’ils ne mangent pas leurs chaussettes, ils ne risquent pas d’être malades avec. Or, la peau est composée de pores et les produits toxiques passent la barrière cutanée, on en est conscient pour les cosmétiques mais pas encore pour les vêtements. Et toute la chaîne est impactée. Les produits chimiques utilisés empoisonnent les travailleurs et l’environnement. Les ouvriers agricoles, ceux qui travaillent dans les usines et les ateliers, les teinturiers semblent se situer en première ligne des risques liées à l’industrie textile. Les ouvriers dans les ports sont évidemment aussi concernés, et ceux des entrepôts des grandes chaînes et les vendeurs dans les boutiques. L’inhumanité du système est perceptible à tous les maillons de la chaîne. Et que dire des modèles de corps proposés par cette industrie – le fameux corps numérique, la taille zéro, une certaine forme d’homogénéité et de beauté artificielle?
Face à ce constat, quelles pistes pour un autre avenir?
J’avoue qu’à la fin de ces quatre ans d’enquête, j’étais déprimée. J’ai alors cherché avec mon éditrice à donner un peu d’amour et d’espoir, mais c’était compliqué. Ce livre se place pourtant dans un avenir révolutionnaire – le marxisme n’a pas sa place ici, on sait très bien qu’il ne fonctionne pas, il a eu sa dose de goulags. Je prône une éducation au corps, un enseignement sur les techniques de manipulation, et plaide pour une révolution des comportements, avec le mouvement mondial Fashion Revolution, notamment. Révolutionner la mode, c’est réfléchir à une mode plus durable et créatrice.
Le livre noir de la mode. Création, production, manipulation, par Audrey Millet, Editions Les Pérégrines.
