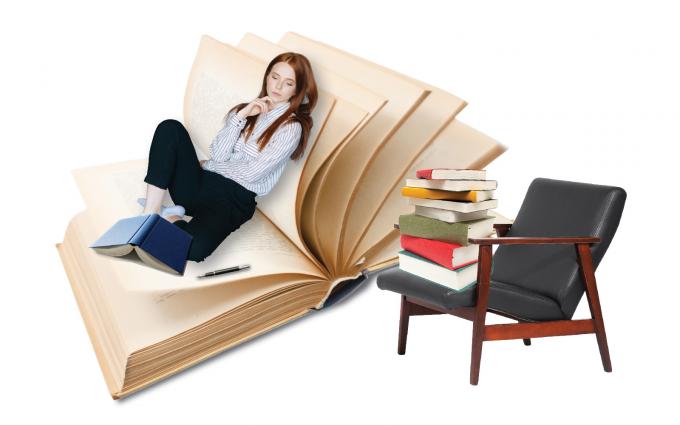Dans son dernier ouvrage L’écriture qui guérit, la psychologue clinicienne Nayla Chidiac démontre que face à l’horreur, l’écriture thérapeutique va nous rendre à nouveau actifs. Et nous remettre sur le chemin du beau qui ramène à la vie.
Dans les romans comme dans les essais, les récits personnels revisitant des événements traumatiques – deuil, inceste, viol, guerre, attentats… – s’imposent de plus en plus comme un genre littéraire à part entière qui a su trouver son public. Pour la psychologue clinicienne Nayla Chidiac, ce constat n’a rien d’étonnant.
Dans un monde en crise, où tout va trop vite, où notre pensée est constamment interrompue, prendre du temps pour écrire mais aussi pour lire peut aider à mettre ses émotions à distance pour apprendre à vivre avec l’indicible.

Celle qui, depuis près de trente ans, propose à ses patients des ateliers d’écriture thérapeutique voit la littérature comme un mur contre l’effondrement. Mais pour elle, il n’y a pas qu’une seule forme d’écrit qui puisse nous sortir du marasme ambiant.
«Même si nous sommes loin d’être tous traumatisés au sens clinique du terme, les images de guerre que l’on voit en boucle, les récits horrifiques qui défilent sur nos écrans peuvent nous amener à une forme d’épuisement et générer de l’anxiété, reconnaît la thérapeute. Ecrire ou lire – des romans mais aussi de la poésie, du théâtre… – peut nous aider à nous projeter dans l’avenir. Et c’est encore mieux si cela ne parle pas de ce que l’on a vécu.» Décryptage.
En quoi l’écriture thérapeutique peut-elle être un outil face à des traumatismes psychiques provoqués par un deuil, une disparition, une agression…?
J’ai lancé mes premiers ateliers d’écriture thérapeutique en 1997, de manière quasiment expérimentale. En préambule, j’aime rappeler cette citation de Salman Rushdie: l’homme est le seul animal qui (se) raconte des histoires. Chacun de nous est une histoire, une narration. Ce qui caractérise le traumatisme psychique justement, c’est l’existence d’une fracture de l’espace et du temps.
Cette narration est en quelque sorte devenue impossible, comme trouée. Parce que quelque chose dans le cours de la pensée s’est fracturé, nous laissant sidérés. J’ai constaté dans ma pratique que l’écriture – à la main, pas à l’ordinateur, j’insiste – va permettre une forme de «tissage» sur cette fracture de l’espace et du temps. Redonner la conscience de l’existence d’un avant et d’un pendant trauma et j’espère d’un après.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
La parole lors d’une session de thérapie n’est donc pas suffisante?
L’écriture thérapeutique pourra apporter une dimension supplémentaire. Tout dépend des besoins du patient, et c’est sans doute là que réside la différence la plus importante avec un atelier d’écriture littéraire. Ici, ce ne sont ni la quantité, ni la qualité qui comptent. Il n’y a pas de jugement esthétique. Je ne leur demande d’ailleurs pas de raconter leur traumatisme. Je donne des consignes pour stimuler un imaginaire qui a pu se retrouver «gelé» par une expérience.
J’observe alors ce qui se met en place pour répondre à ces instructions. Il est essentiel que la personne se sente en sécurité dans le cadre de l’exercice. On ne peut jamais prédire ce qui va en ressortir. Le poète René Char le dit mieux que personne: «Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d’eux.»
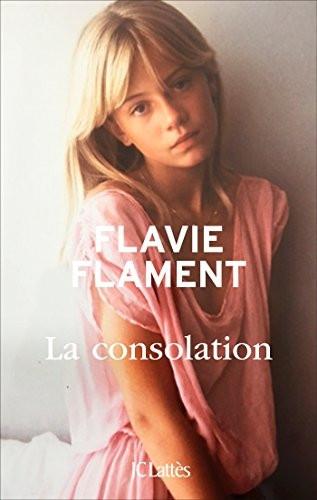
Ces écrits, on imagine, ne sont pas toujours destinés à être publiés. Pourtant, les récits autobiographiques – souvent le fait de personnalités médiatiques – relatant des événements traumatiques sont de plus en plus nombreux. Qu’est-ce qui peut expliquer que certaines personnes souhaitent aller plus loin?
Les uns vont avoir envie de témoigner pour aider, montrer au monde qu’il est possible de s’en sortir. Les autres espèrent de cette manière obtenir une forme de réparation. C’est se dire «si je suis lu, si je suis soutenu, cela va m’aider à me reconstruire».
‘Ce qui doit jaillir, jaillira. Ce qui compte, c’est de poser sa pensée pour ne pas la laisser vous submerger.’
Si c’est publié, c’est qu’il y a un public pour cela… Qu’est-ce qui nous pousse à lire ces récits souvent dramatiques, que l’on soit passé ou non par les mêmes épreuves?
La nuance est importante, en effet. Et il est impossible de généraliser. Certains trouveront de l’aide dans ces récits. D’autres vont s’en détourner. L’une de mes patientes qui adore la lecture me disait récemment qu’elle ne supportait plus de lire les récits autobiographiques de personnes qui avaient subi le même trauma qu’elle. Elle avait justement besoin de s’évader, de se réfugier dans cette bulle imaginaire qui aide à survivre.
Pour celles et ceux qui n’ont rien vécu de tel, cela peut avoir un côté rassurant. De se dire que l’on peut malgré tout s’en sortir. Qu’en comparaison avec ce par quoi sont passés ces gens, votre vie n’est pas si mal finalement. Cela peut aider à relativiser.
Nous vivons une époque particulièrement angoissante, les images de guerre sont partout au point que beaucoup de gens se disent «traumatisés», mais peut-on l’être réellement par récits interposés?
Je pense qu’avant toute chose il faut revenir à la définition clinique du traumatisme: c’est une rencontre avec le réel de la mort. Ce n’est pas «j’ai pensé mourir», c’est «j’ai failli mourir». On assiste aujourd’hui à une forme de généralisation de l’usage du mot trauma. Ces images de guerre que l’on voit en boucle, cela peut générer un sentiment de déréalisation – je n’y crois pas, c’est un film.
Ou au contraire vous affecter au point d’amener à une forme d’épuisement qui peut s’avérer cliniquement perturbant. Conduire à une anxiété terrible. Entraîner de la dépression. Tout cela oui… Mais il ne s’agit pas de traumatisme.
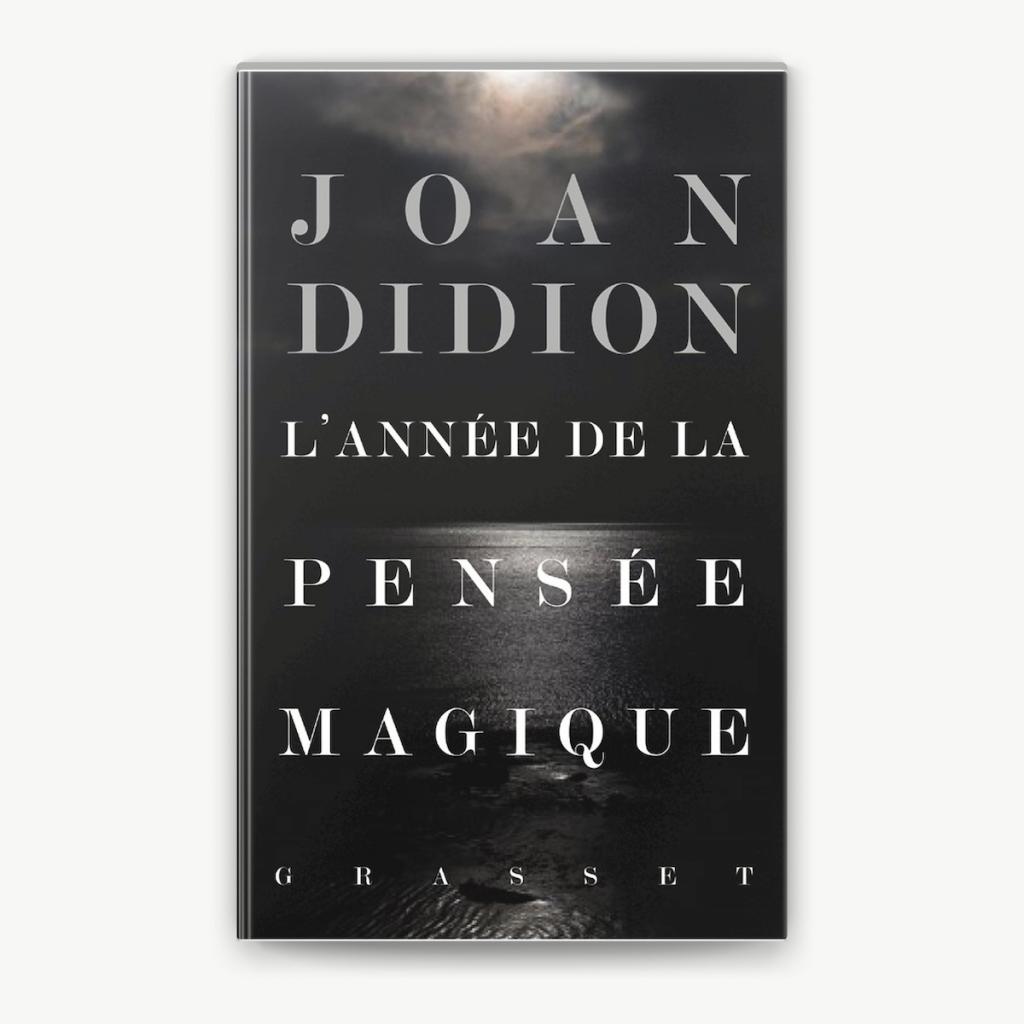
En 2006, l’autrice américaine publie déjà ce qui est désormais considéré comme «le» classique de la littérature sur le deuil. Elle nous raconte la folie du deuil et dissèque la plus indicible expérience – et sa rédemption par la littérature.
Pourquoi alors s’intéresser à ces récits de mort?
Il y a toujours eu une forme de curiosité humaine par rapport à la mort. Souvenez-vous du mythe d’Orphée descendu aux Enfers pour ramener Eurydice. On apprivoise quelque chose de l’ordre de la mort à travers le témoignage de quelqu’un qui l’a approchée de près.
Prenons les conflits armés dont nous parlions tout à l’heure. La guerre se rapproche mais ici nous ne sommes pas en guerre. L’écriture et la lecture permettent de remettre les pensées et les émotions à leurs places. De poser une distance.
Est-ce pour aider à poser cette distance justement que vous conseillez aux personnes que vous soignez et qui vivent en zone de guerre – au Liban en l’occurence – de s’astreindre à une routine quotidienne?
Quand je leur suggère de commencer la journée par du sport, une douche glacée, un thé chaud et 15 min d’écriture thérapeutique, c’est justement pour mettre en place une sorte de sas où le corps et l’esprit sont réunis dans l’écriture. Avant de se retrouver happés par les mauvaises nouvelles qui pleuvent sur les réseaux sociaux, ce que l’un de mes patients appelle à raison les «junk news» qui nous entraînent dans une forme de fascination face à l’horreur.
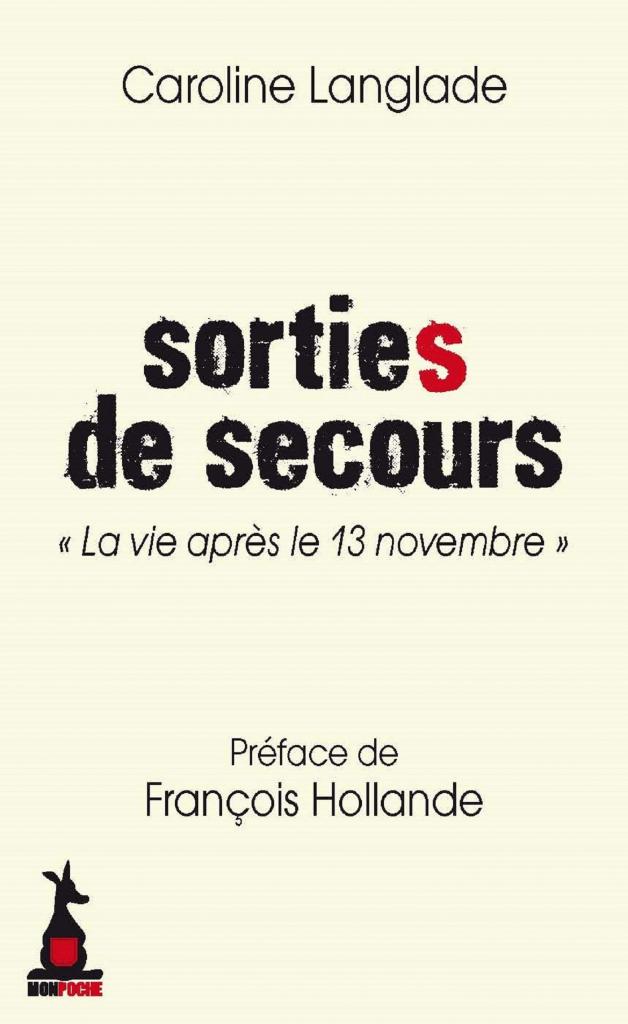
Le 13 novembre 2015, au Bataclan, Caroline Langlade est l’une des quarante personnes qui vont se retrouver otages des terroristes. Du huis clos de l’attaque au combat quotidien pour guérir les blessures visibles ou invisibles, son récit est aussi une histoire de solidarité.
Si l’on pense au viol ou à l’inceste, ces récits sont longtemps restés cachés, comme tabous. Cela rend-il ces témoignages de l’indicible nécessaires pour les victimes mais aussi la société finalement responsable d’avoir trop longtemps ignoré ces souffrances?
Il faut bien sûr qu’on en parle. Mais le temps du récit est personnel à chacun. Et tout le monde ne souhaite pas rendre son histoire publique, ce n’est pas la fonction de mes ateliers. L’écriture thérapeutique permet, comme je l’ai dit, de tisser des liens. De reconnaître ce qui vous est arrivé, de quitter l’état de vigilance permanente dans lequel le traumatisme vous a plongé. Une sentinelle qui n’a jamais de temps de repos va s’effondrer, succomber.
‘L’écriture et la lecture permettent de remettre les pensées et les émotions à leur place. De poser une distance.’
Peut-on être aussi en hypervigilance lorsque l’on a oublié son traumatisme, un oubli qui tient lieu de survie?
Tout à fait. Dans le cas d’un inceste ou d’une agression sexuelle chez l’enfant, par exemple, pour se protéger, il va se dissocier, «oublier» ce qui lui est arrivé. Mais rester quand même en état de vigilance sans savoir ce qui le justifie. Avec l’écriture thérapeutique, vous n’allez pas oublier, ni même accepter.
Mais, si je peux me permettre cette métaphore que j’aime bien, ranger ce «chapitre» dans la bibliothèque de votre vie. Le patient peut y revenir, mais aussi puiser dans l’avant et aussi dans l’après. Il devient actif et non plus passif. C’est pour cela qu’il est important d’écrire à la main, pour engager le corps.
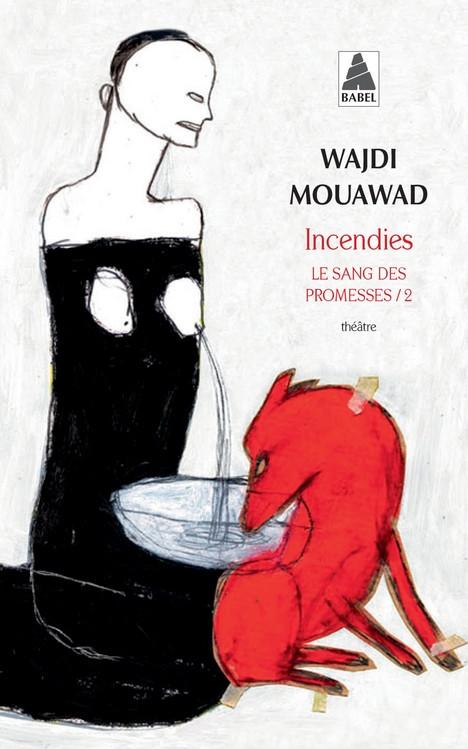
Dans cette pièce de théâtre qui raconte sans jamais la nommer l’horreur pure de la guerre du Liban entre 1975 et 1990, le dramaturge Wajdi Mouawad revisite le mythe d’Oedipe entraîné lui aussi dans la mère de toutes les guerres, celle de Troie qui semble à jamais se répéter.
Pour revivre et non plus simplement survivre, vous insistez sur l’importance de réussir à se projeter dans l’avenir. Et cela passe souvent par la capacité à écrire sur autre chose que son traumatisme…
Sans cela il n’y a pas de guérison. Dans la lecture, c’est pareil. Et la forme des écrits est aussi importante. La poésie par exemple fait des merveilles. Parce que ce sont des fragments, des formes courtes. Elle peut vous emmener partout… Plus vous lisez des formes différentes, plus vous trouverez celle qui vous convient à un moment de votre vie.
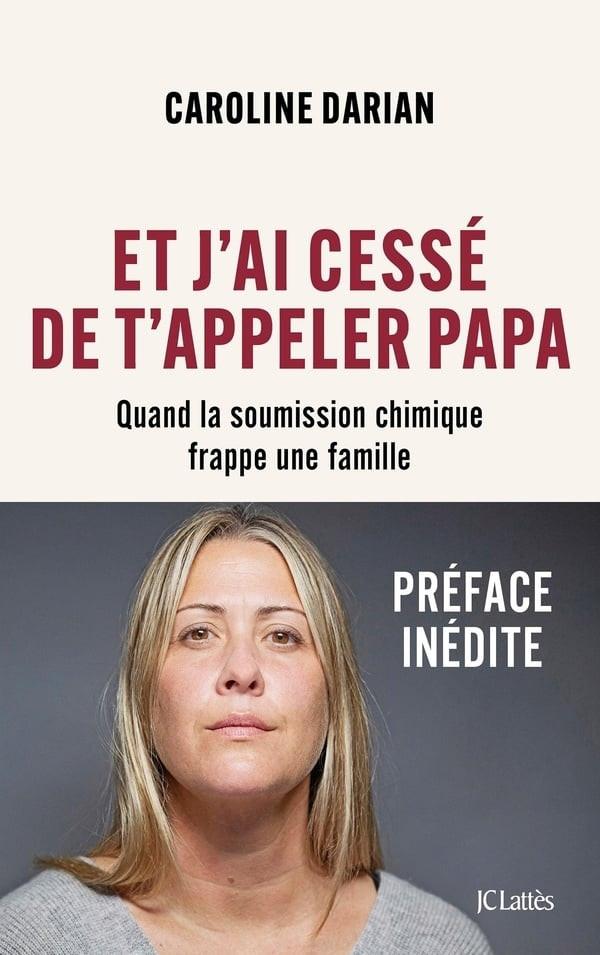
Dans ce premier livre sur ce que l’on appelle désormais l’affaire Mazan, Caroline Darian, qui vient à son tour de porter plainte pour viol contre Dominique Pelicot, raconte comment son père, en usant de la soumission chimique, a livré sa femme inconsciente à des dizaines d’inconnus pendant près de dix ans.
Dans votre ouvrage d’ailleurs, vous terminez avec un abécédaire d’auteurs ayant écrit sur la guerre où l’on retrouve aussi bien Tolstoï et Umberto Eco que le dramaturge Wajdi Mouawad…
C’est important de ne pas hiérarchiser les écritures. Il faut trouver celle qui vous permet de tenir. Prenez la forme que vous voulez du moment qu’elle vous serve de cadre. Après, ce qui doit jaillir, jaillira. Ce qui compte c’est de poser sa pensée pour ne pas la laisser vous submerger.
Et c’est la même chose pour celui ou celle qui lit. Chez les grands auteurs, on peut aussi compter sur la beauté du texte. N’oublions pas que face à l’horreur, la beauté au sens large du terme et l’amour nous ramènent du côté de la vie.
L’écriture qui guérit, par Nayla Chidiac, Odile Jacob.