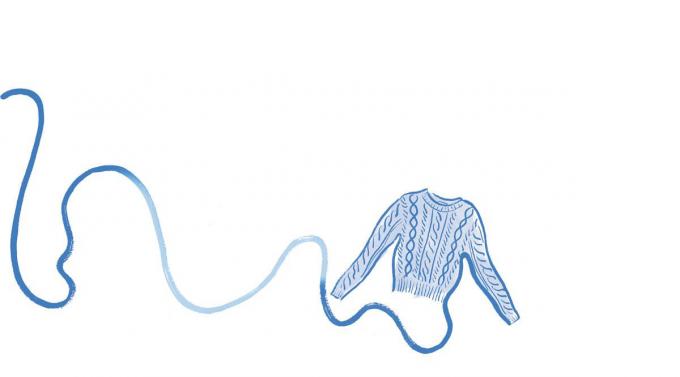Il y a dix ans, le Belge Bruno Pieters bousculait la fashion sphère, lançant Honest by, une marque aujourd’hui disparue, prônant la traçabilité de sa fabrication. Depuis peu, son initiative éthique trouve écho dans le milieu.
Cela fait quelques années que les étiquettes d’emballage de viande affichent le lieu d’abattage, que le code imprimé sur les oeufs indique si le poulet a été élevé en plein air et que des labels tels Fairtrade et UTZ Certified indiquent le degré écologique et social lié à la production des denrées. Mais désormais, ces notions envahissent la mode. En octobre dernier, le New York Times titrait: « La plus grande tendance fashion ne porte pas sur la longueur des jupes, mais sur leur durabilité et leur traçabilité. »
En Belgique toutefois, cette prise de conscience de la sphère fashion n’est pas tout à fait neuve. En janvier 2012, « notre » Bruno Pieters lançait en effet Honest By, une initiative ambitieuse. La marque renseignait sur le nombre de mètres de fil utilisés pour confectionner un vêtement, la rémunération de la couturière, celle du directeur, l’origine des boutons, le nom du teinturier, etc. Le créateur estimait alors que son projet était la première entreprise 100% transparente au monde. Son but? Enrayer l’écoblanchiment. « On débourse plusieurs milliers d’euros pour un sac à main d’une maison de luxe française, pensant qu’il est fabriqué localement. En réalité, il est produit dans des pays à bas salaires, mais sa finition est faite dans l’Hexagone, donc étiqueté « made in France ». Le consommateur est dupé », regrettait-t-il à l’occasion du lancement du label. Avec Honest By, Bruno Pieters est l’une des figures-clés de cette tendance à la transparence. « Ces dernières années, le monde de la mode s’est métamorphosé. Informer le consommateur n’est plus une idée utopique », déclarait-il en octobre 2018, lors de l’annonce de la cessation de sa marque. Désormais, bien que cette évolution soit encore discrète, l’ouverture à la traçabilité se fait sentir. Grâce notamment aux innovations numériques.
Les chemins de la confection
Récemment, la jeune marque Wright a, à son tour, misé sur cette transparence. Depuis l’été dernier, les étiquettes de ses articles ont un code QR qui, une fois scanné, permet de suivre tout le processus de production: depuis le design au conditionnement en vue du transport, en passant par la coupe des tissus. « En partageant ces informations, nous voulons montrer à nos clients le temps, le travail et l’expertise liés à nos vêtements. Ainsi, nous supposons que ceux qui les portent estimeront mieux la valeur des pièces et qu’ils en prendront davantage soin, précise Nathalie De Nil, CEO du label. Cela demande un effort considérable à notre équipe parce qu’elle doit consigner chaque action. Mais cela ne nous empêchera pas d’aller encore plus loin, en ajoutant les noms et photos des personnes qui les confectionnent, pour rendre les modèles plus personnels. Pour l’instant, nous n’avons pas l’ambition de Bruno Pieters, qui communiquait aussi le nom du fabricant de boutons et de fils. Un excès d’information peut gêner les clients ; nous cherchons le bon équilibre. »
Wright recourt à la technologie de quiFACTum, une start-up belge nominée en novembre dernier lors de nos Belgian Fashion Awards, dans la catégorie « Changemaker of the Year ». Mathias Slabbinck et Christof Ameye ont débuté l’aventure en octobre 2020, suscitant immédiatement l’intérêt. Le premier partage la vision de Nathalie De Nil. « Honest By était un choc. Non seulement pour le monde de la mode, mais aussi pour le consommateur. En particulier via les informations financières que Bruno Pieters publiait. Le prix de vente était quatre fois plus élevé que le prix coûtant. C’est courant, mais peut-être trop perturbant aux yeux du grand public. A mon sens, il faut proposer de la transparence à un niveau qui soit acceptable pour le consommateur. »
Les marques rechignent encore u0026#xE0; communiquer certaines informations, comme les fabricants et les sous-traitants, car la concurrence est attentive u0026#xE0; ces u0026#xE9;lu0026#xE9;ments.u0022 Daniela Ott, directrice de la plate-forme Aura
L’idée avait déjà titillé Mathias Slabbinck en 2013, lors de l’effondrement dramatique des ateliers textiles du Rana Plaza, au Bangladesh, qui avait entraîné le mouvement Fashion Revolution sous le slogan « Who made my clothes »? A l’époque, il travaillait dans l’entreprise familiale de linge de maison de luxe, Mirabel Slabbinck. « Depuis des années, nos couturières prenaient note de leurs réalisations et des destinataires, pour calculer le prix coûtant. J’ai voulu l’exploiter comme matériel marketing, mais le projet n’a pas abouti. Lorsque j’ai quitté l’entreprise, j’ai relancé cette idée. » Actuellement, quiFACTum a treize clients, dont la plupart veulent garder l’anonymat. En raison de la crise du coronavirus, beaucoup d’autres sont en attente. « La vraie transparence est un sujet délicat, en particulier en Belgique. Souvent, nos clients préfèrent taire certaines choses, notamment le fait que le label « Made in Belgium » ne reflète pas tout à fait la réalité. Je suis convaincu que cela évoluera encore. Mais un tel changement des mentalités exige du temps, pour les marques comme pour les consommateurs. La transparence actuelle leur donnera une image plus réaliste d’un processus de production. La jeune génération est particulièrement demandeuse de limpidité. Je suppose que ce sera une obligation légale d’ici peu et qu’il y aura de multiples développements. Je pense à une visite virtuelle d’atelier par le biais d’un métavers. »
Des initiatives internationales
Le nom même de cette entreprise du plat pays, quiFACTum, résume tout le concept. « Nous rapportons des faits. Ainsi, les consommateurs peuvent prendre une décision en connaissance de cause. C’est à eux de voir s’il s’agit d’un choix durable ou d’un plaisir coupable », ajoute Mathias Slabbinck. La société travaille avec un système d’abonnements et vise les PME. En Belgique, cette boîte est la première à proposer ce service mais sur le plan international, les concurrents, souvent de plus grande taille, se bousculent.
C’est le cas de Provenance qui a conçu un logiciel traçant les chaînes de production. Comme le lieu de récolte du coton, la rémunération des travailleurs, le nombre de litres d’eau requis et la quantité de CO2, qui y sont visibles. Le label danois Ganni en est utilisateur. Autre exemple: Fibretrace, qui ajoute des pigments photosensibles aux fibres textiles résistant au processus de production. Comme ils travaillent avec plusieurs pigments par lots de coton, de laine ou d’autres matières, la traçabilité est assurée. Vous scannez le vêtement et vous voyez son itinéraire depuis le champ de coton jusqu’au rayon de magasin. Contrairement à un code QR apposé sur une étiquette, l’information est inscrite dans le vêtement, la fraude (en cousant une autre mention) est impossible.
En octobre, la Sustainable Markets Initiative, soutenue par le prince Charles, a par ailleurs présenté le Digital ID, outil de traçabilité du champ à la vente. Les quinze membres de la Fashion Taskforce l’introduiront dès cette année, notamment Armani, Stella McCartney, Burberry et Chloé, mais aussi Vestiaire Collective et Zalando. « En plus d’infos sur les matériaux et la production – telle que l’usine qui a assuré la confection – il comporte un volet circulaire: comment réparer, recycler ou revendre la pièce? », explique Federico Marchetti, président du groupe de travail.
Découvrez aussi: notre shooting réalisé entièrement avec des pièces vintage
Une méconnaissance en chaîne
Mais le secteur de la mode est-il vraiment prêt à assumer un tel niveau de contrôle? Bonne question. Selon l’Indice de transparence 2021, grande enquête annuelle menée par Fashion Revolution, les marques en savent peu sur le processus de confection de leurs propres vêtements: 101 des 250 entreprises ont pu fournir une liste de leurs ateliers de production, mais seules 18 des 250 disposaient de quelques données sur leurs fournisseurs de matières premières. Les griffes ignorent le lieu de tissage de leurs étoffes, le nom de l’éleveur qui a fourni la laine ou de l’usine qui a fabriqué les boutons. Conséquence: des chaînes complexes qui impliquent des dizaines d’acteurs en provenance de pays complètement différents.
Nous rapportons des faits. Ainsi, les consommateurs peuvent prendre une du0026#xE9;cision en connaissance de cause. C’est u0026#xE0; eux de voir s’il s’agit d’un choix durable ou d’un plaisir coupable.u0022 Mathias Slabbinck, CEO de quiFACTum
Toutefois, contrairement aux mastodontes comme Zara qui ont des milliers de partenaires, les jeunes marques de petite taille sont particulièrement sensibles à la cause. Et comme leurs collections sont limitées, elles travaillent généralement avec moins de sous-traitants. Elles les connaissent personnellement et peuvent leur demander des informations. Par exemple, la marque de jeans américano-suédoise Amendi réalise des labels « Fabrication Facts », par analogie aux « Nutrition Facts », visibles sur les denrées alimentaires. Ils comportent des informations détaillées sur le matériau, la consommation d’eau, une analyse des coûts et le nombre de personnes qui y ont contribué. La marque de laine britannique Sheep’s Inc. insère, elle, dans tous ses pulls en mérinos une étiquette NFC ( NDLR: la technique qui permet de payer sans contact), que l’on scanne à l’aide d’un smartphone pour y lire toutes sortes d’infos – nom du mouton, date de la tonte, lieu de pâturage… Mais la laine provient-elle réellement du mouton en question? Quoi qu’il en soit, ces éléments créent un lien émotionnel avec le vêtement.
La révolution blockchain
L’arme redoutable dans ce désir de transparence? La blockchain, nouveau réseau numérique permettant la sauvegarde de données, qu’il est ensuite impossible de modifier. On peut juste y ajouter de nouvelles précisions, sur la production et le lieu d’achat sous forme de passeport numérique entre autres. Et le marché florissant de la mode et des accessoires de deuxième main a trouvé ici un remède efficace contre la contrefaçon. The Aura Blockchain Consortium montre à quel point les maisons de luxe sont avides de suivre cette voie. En effet, cette nouvelle plate-forme à but non lucratif réunit LVMH (Louis Vuitton), Prada et Richemont, qui y travaillent en étroite collaboration, alors que ce sont de féroces concurrents qui ne se supportent pas en temps normal! Récemment, OTB, le groupe derrière Diesel et Maison Margiela, s’est joint à eux.
Aura met au point un passeport qui retrace le parcours complet d’un article, depuis les matières premières brutes à la vente en seconde main. « Voyez cela comme un clone du produit contenant tous les certificats d’authenticité, explique Daniela Ott, directrice de la plate-forme. Nous n’en sommes qu’aux balbutiements. Les marques rechignent encore à communiquer certaines informations, comme les fabricants et les sous-traitants, car la concurrence est attentive à ces éléments. Les mentalités doivent évoluer, mais il reste des obstacles: les labels aussi doivent collecter ces données, tout le monde n’en est pas là. » Ce sont peut-être deux des raisons pour lesquelles Chanel et le groupe de luxe Kering (Dior) refusent de prendre part à Aura.
Mais la directrice y voit un outil de marketing inestimable. « L’avantage de la blockchain est qu’elle permet aussi de sauvegarder des photos et des vidéos, et donc de raconter des histoires. Le consommateur voit qui a confectionné son sac à main. Cela répond à l’attente du jeune client pour qui la transparence est un must. » Quoi qu’il en soit, cette traçabilité grandissante reflète la démocratisation de la mode. Le consommateur peut réellement vérifier si les marques tiennent leurs promesses. Adieu l’écoblanchiment?